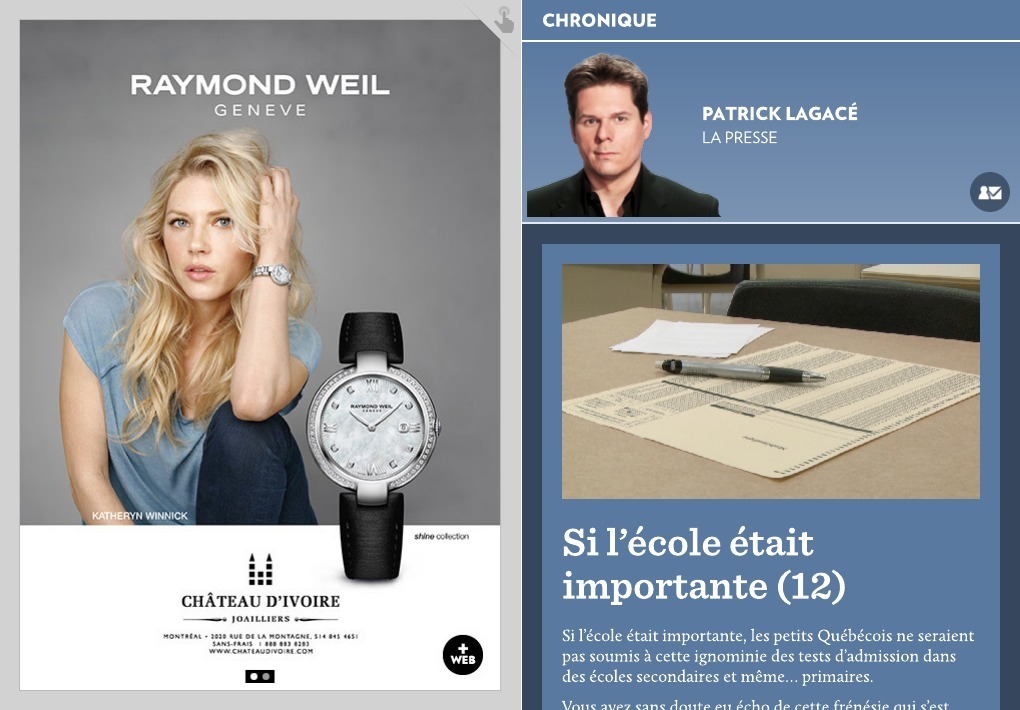Si l’école était importante (12)
Si l’école était importante, les petits Québécois ne seraient pas soumis à cette ignominie des tests d’admission dans des écoles secondaires et même… primaires.
Vous avez sans doute eu écho de cette frénésie qui s’est emparée – comme chaque automne – du milieu scolaire il y a quelques semaines, à l’aube des tests d’admission dans les écoles secondaires privées du Québec.
Des milliers d’enfants, partout au Québec, ont subi des examens dans l’espoir d’être admis dans une « bonne » école. Je mentionne les écoles privées, mais on peut aussi parler d’un tas d’écoles publiques qui sélectionnent leurs élèves de la même façon, notamment les écoles internationales.
Ai-je dit que ces tests causaient de la « frénésie » dans le milieu scolaire ? C’est un euphémisme, veuillez m’en excuser. Ces tests causent du stress chez des milliers d’enfants, certains font pipi dans leur culotte, d’autres vomissent. Pas tous. Mais la course à la « bonne » école est suffisamment importante pour causer du stress à des enfants qui ne devraient pas stresser avec ça.
On peut blâmer les parents qui paient des tuteurs qui guident – pour près de 50 $ l’heure – leurs enfants afin qu’ils arrivent bien préparés à ces examens d’admission. Il y a très certainement des parents dans le lot qui sont du type mon-enfant-doit-devenir-neurochirurgien-et-astronaute-et-ça-commence-par-une-bonne-maternelle-dans-une-école-privée.
On peut reprocher à ces parents de mettre une pression épouvantable sur les épaules de leurs enfants, en mettant un accent démesuré sur la préparation à ces tests. Une enseignante d’une école internationale, habituée à voir de ces parents hyperperformants aux tests d’admission de son école, m’a décrit l’enfant de ce genre de parents, dans un récent échange par Facebook : « l’enfant-trophée », dont la « réussite » rejaillit bien évidemment sur ses géniteurs.
Mais il y a plus que ça.
Il y a la perception que l’école publique, c’est de la merde. Et que les écoles qui choisissent leurs élèves sont de bonnes écoles, le genre d’école où il « faut » aller.
Un ami de mon fils a récemment fait ces tests, dans deux écoles secondaires de Montréal. Il n’a pas été admis dans l’une de ces écoles. Il l’a été dans l’autre. Voici l’échange que j’ai eu avec lui, à ce sujet :
— Étais-tu nerveux, aux tests ?
— Au premier, non. Au deuxième, oui. Je savais que si j’échouais, j’irais dans le public.
— Et c’est pas bien, le public ?
— Ben… Il y a de l’intimidation et des batailles entre élèves, au public.
Vous me direz que ce n’est qu’une conversation avec un enfant. Le hic, c’est que ce petit bonhomme résume exactement les échanges que j’ai eus au fil des années avec des parents de tous les horizons, parents qui ont une vision apocalyptique de l’école publique.
Tenez, voici les mots de Karine, une mère de la Rive-Nord, qui m’a écrit hier pour me raconter que son enfant avait passé un test d’admission pour entrer à la maternelle d’une école privée : « L’école de quartier n’avait pas bonne réputation. Les voisins nous disaient que c’était une bonne école si on voulait apprendre à fiston à bien se battre… »
Et les mots d’une mère dont l’enfant a échoué au test d’admission d’une école publique, mots qui m’ont été rapportés par une enseignante de Montréal (tenez-vous bien) : « Le projet de vie de mon enfant est complètement détruit… »
Cette vision apocalyptique est-elle exagérée ? Assurément. Toutes les écoles publiques ne sont pas de petits Mossoul où on joue à la roulette russe avec l’éducation des petits Québécois.
Mais l’école publique a été malmenée, depuis des années. Ce n’est pas l’exception, c’est la règle : les gouvernements péquistes et libéraux se sont lavé les mains des compressions et des maigres augmentations à l’Éducation sous la barre des hausses de coûts de programme, ce qui a fatalement mené à des coupes sauvages dans les services aux élèves.
Aide aux devoirs, murs pleins de champignons, toits qui coulent, éducatrices spécialisées mises à pied, de même que des orthopédagogues et des orthophonistes et des psychologues, sans oublier l’empilage d’élèves en difficulté dans les classes dites régulières : c’est le lot de l’école publique depuis des années et des années.
Est-ce le cas de toutes les écoles publiques ?
Non.
Mais c’est le cas de suffisamment d’écoles pour que tomber dans une « bonne » école relève souvent de la loterie, une loterie basée sur le code postal, pour que l’école publique, dans l’imaginaire de bien des parents, devienne synonyme de cul-de-sac. C’est ça, la grande injustice, qui a des effets dans le réel.
J’ai déjà expliqué dans cette chronique en 2012 pourquoi mon fils s’est retrouvé au privé, au primaire. L’école du quartier s’était en effet révélée conforme aux rumeurs que j’entendais dans le quartier depuis longtemps : une école sans âme, à la dérive (on me dit que les choses ont changé, pour le mieux). Quand l’école privée m’a appelé, je n’ai pas hésité : j’ai dit oui. Je ne suis pas le seul.
On peut faire le procès des écoles privées, on peut vivre dans la fiction qui veut que si les subventions au privé étaient abolies, l’école publique se retrouverait comme par magie dans un univers où elle ne manquerait de rien. On peut. Mais je crois qu’on se leurre, si on croit à cette fiction.
L’école publique a été négligée au fil des décennies et l’obsession des parents qui poussent leurs enfants, parfois d’âge préscolaire, vers des écoles qui sélectionnent les élèves avec des tests par définition stressants n’est que le reflet d’une réalité : les parents votent avec leurs pieds. Ils ne veulent pas jouer à la loto avec l’avenir de leurs enfants, même si leurs craintes sont exagérées.
Si l’école était importante, TOUTES les écoles publiques seraient de bonnes écoles. Nous serions obsédés par cela, comme nous le sommes par les nids-de-poule et les hot chicken servis aux vieux dans les CHSLD. L’exception, ce serait l’école à champignons et moisissures, ce serait l’école où six, sept élèves en difficulté se retrouvent en classes régulières, sans l’appui de professionnel… Ce n’est pas l’exception. Si l’école publique a mauvaise presse, c’est parce que ce préjugé a un ancrage dans le réel.
Le drame, c’est que l’école publique du coin est censée donner une chance égale à tous les enfants de faire leur chemin dans la vie et qu’en 2016 au Québec, des milliers de parents voient plutôt l’école publique du quartier comme un obstacle au développement de leur enfant.
Ont-ils raison ? Ce n’est pas important : c’est la perception et la perception, c’est la réalité. Il faudra des années pour défaire cette perception. Peut-être même qu’il est trop tard.
C’est pourquoi, cet automne, des milliers de petits Québécois se sont pliés à un exercice de sélection brutal par essence : des tests de sélection pour être admis dans une « bonne » école.
La « bonne » école, si l’École – avec un grand É – était importante, ce serait celle du quartier.