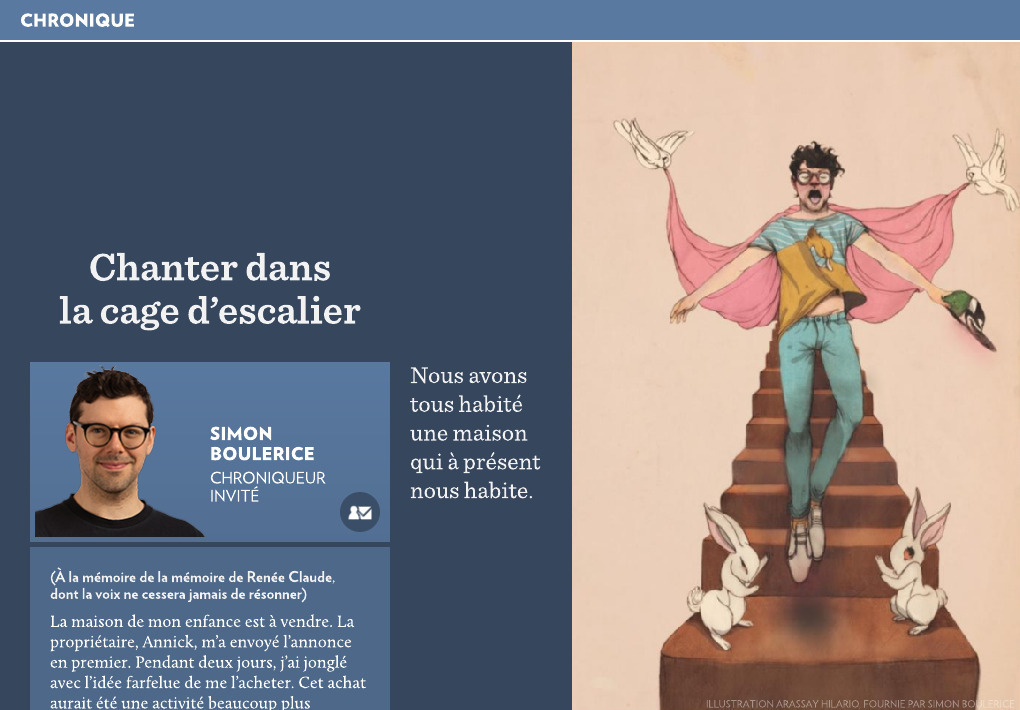Chanter dans la cage d’escalier
(À la mémoire de la mémoire de Renée Claude, dont la voix ne cessera jamais de résonner)
La maison de mon enfance est à vendre. La propriétaire, Annick, m’a envoyé l’annonce en premier. Pendant deux jours, j’ai jonglé avec l’idée farfelue de me l’acheter. Cet achat aurait été une activité beaucoup plus nostalgique qu’un projet logique. Pour le travailleur autonome que je suis, dépourvu de permis de conduire et bien implanté dans la métropole, me fantasmer un pied-à-terre à Saint-Rémi était probablement risible.
Il y a quelques années, Annick est venue me rencontrer au Salon du livre de Montréal. Elle faisait la queue avec une ferveur toute spéciale ; je me disais : voici une lectrice vorace bonne à rassasier mon ego. Et quand son tour est venu, elle s’est avancée vers moi, mais plutôt que de me demander un autographe, elle a brandi l’écran de son iPhone où irradiait la photo d’une maison que je connaissais trop bien. Elle a simplement dit : « Je vis dans la maison de ton enfance. »
Ça faisait près de 17 ans que mes parents avaient vendu la maison dans laquelle j’avais grandi. Dix-sept ans de ma vie dans cette maison, 17 ans loin d’elle. J’espérais ardemment que ma notoriété municipale soit suffisante pour que Michel Barrette me convie à son émission Viens-tu faire un tour ? Vivre des retrouvailles avec la maison en agrégat beige de la rue Poupart à Saint-Rémi aurait été une grande joie, mais l’invitation n’est jamais venue. Alors c’est la maison elle-même qui s’est présentée à moi, par le truchement de la solaire Annick.
L’histoire a quelque chose d’émouvant : jeune ado, j’aimais dessiner, et cette passion m’avait amené à faire une murale au sous-sol, sur le gyproc désolé. Parce que le plagiat ne me gênait pas, j’y avais reproduit Des glaneuses de Millet en signant fièrement mon nom. Ma paresse était consistante à l’époque ; j’avais abandonné ma murale une fois l’étape de l’esquisse au crayon HB conclue. Je me l’explique mal, mais les gens à qui mes parents ont vendu la maison n’ont pas cru nécessaire d’effacer « mon œuvre », de sorte que quand Annick, qui est peintre, a acheté la maison à son tour, elle est tombée face à face avec un plagiat cute d’enfant de 14 ans. Mue par un désir de transmission, de continuité, elle a choisi de peindre mes Glaneuses en plus de chacune des fioritures de ma signature. Un jour, m’ayant vu à la télé, elle a vibré : Simon Boulerice ! Mais c’est le petit gars du sous-sol !
Elle a donc lu mes livres, puis constaté que la plupart de mes histoires se déroulaient à Saint-Rémi. Elle est généreusement venue à moi pour que je retourne visiter mes origines. Le cœur déjà chambranlant, j’y ai emmené ma sœur, convaincu que j’allais vivre un moment émouvant. Annick m’a alors dit : « On va garder ta chambre pour la fin. » C’était l’injonction des larmes ; je me devais de pleurer dans la chambre de mon enfance. Mais on ne choisit pas ce qui nous bouleverse, et ma chambre m’a laissé presque indifférent. Ce n’était plus ma chambre, et c’était très bien ainsi. Je me suis avoué que j’avais finalement un cœur de pierre. Puis, en descendant l’escalier central, au terme de la visite qui avait été belle, mais aucunement remuante, j’ai joué de la harpe avec les barreaux de la rampe inchangée. La musique qui en a jailli m’a replongé directement dans mes souvenirs – l’époque où, chaque matin, je descendais les marches de manière grandiloquente à la Gloria Swanson (All right, Mr. DeMille, I’m ready for my close-up), l’époque surtout où chaque jour, au retour des classes, je chantais dans la cage d’escalier. Le répertoire de Whitney Houston était mien (I get so emotional baby every time I think of you), et l’acoustique avantageuse me faisait croire à tort que j’accotais Whitney vocalement. Ma Whitney intérieure venait d’être débusquée, et les larmes m’ont monté aux yeux. Je pleurais dans la cage d’escalier, parce que l’écho de ma jeunesse se prolongeait dans ma vie d’adulte.
Cette semaine, alors même que j’ai reçu en exclusivité la publicité de la vente de ma maison, j’ai mis de l’ordre dans les poèmes écrits par des personnes âgées des dix résidences de Piero-Corti où j’ai offert des ateliers d’écriture. Alors que l’illustrateur Rogé portraitise les visages burinés, tavelés et lumineux des poètes, j’orchestre leur recueil qui deviendra Notre enfance se prolonge (titre de travail). Je relis les poèmes de Lucette, d’André, de Claire, de Claudette, d’Yvette, d’Yvaine, d’Eunice… Tous traquent leur enfance, revisitent leurs joies et leurs chagrins d’hier. Et en les parcourant, je suis ému des mots vétustes, craquants comme un plancher de bois centenaire au milieu de la nuit.
C’est samedi et j’ai 15 ans
Jour de pain
On déverse la farine dans le pétrin
Je tourne la manivelle
[…]
Maman sort du four une paire de fesses dorées
Ce pétrin-là est nouveau pour moi, et il sonne beau, sorti des boules à mites par Madeleine, 74 ans. Cette marque de cigare – White Owl ou White Old ? – que Suzanne, 83 ans, se remémore, en ajoutant qu’elle enfilait la bague du cigare à son doigt pour des fiançailles avec son fumeur de père. Je suis ému par l’universalité de tous leurs souvenirs. Le souvenir ludique de Jovette est sans doute un peu le vôtre :
Vendredi soir après souper
ma sœur, mon frère et moi
on se presse pour prendre notre bain
j’ai 8 ans et c’est fête ce soir
en pyjama et bas de laine
faire briller le plancher du passage
patinoire de parquet du corridor
jouer au hockey avec des guénilles roulées serré
alarme de fin de période
l’heure d’aller se coucher
dans son habit de joie et de transpiration
Je repense surtout à la belle Shirley Marcheterre, 74 ans. Elle me disait dans le creux de l’oreille : « Je ne me rappelle pas de rien. Aucun souvenir. Tout est blanc dans ma tête. » Elle cherchait à faire mentir mon ludique prof de biologie qui disait : « L’être humain est composé à 60 % d’eau et à 40 % de souvenirs. »
Mais en réveillant de vieilles sensations, en remuant les odeurs et les musiques comme on retourne la terre pour la rendre meuble, fertile, quelque chose a surgi de la mémoire de Shirley. Ensemble, nous avons procédé au bêchage dans sa mémoire, et un incendie est survenu, pareil à une éclaircie :
Dimanche matin l’été à Amqui
j’ai 4 ans et la maison devient rouge
le feu se déclare dans le grenier
et avale les pièces d’une bouchée
mon père nous soulève mon frère et moi
à l’abri chez le voisin
le spectacle époustouflant de perdre son nid
mon père dans les flammes
pour sauver ce qu’il peut
trop tard
tout s’effondre derrière lui
il n’y a plus rien
que nos vêtements sur le dos
mon père revient les mains et le bout du nez brûlés
ton nez est trop gros, papa
un peu de rire dans notre malheur
Lire la somme des poèmes m’amène à ce constat : nous avons tous habité une maison qui à présent nous habite. Les mots de Monique Paquette, 85 ans, s’imposent ici : je regarde ma jeunesse dans le parquet ciré. Mon enfance à moi reluit dans chacun des barreaux de la rampe d’escalier.
Annick aura beau vendre la maison en agrégat de la rue Poupart à un autre que moi, ma voix résonnera encore dans cette cage d’escalier. Elle y résonne présentement.
Pas de doute, je l’ai bel et bien, mon pied-à-terre à Saint-Rémi.
Simon Boulerice est l’un des quatre chroniqueurs invités à qui La Presse offre, en alternance, une tribune chaque dimanche ce printemps. Ne manquez pas ses chroniques et celles de l’auteur David Goudreault, de la rappeuse Jenny Salgado et de la journaliste et animatrice Noémi Mercier.