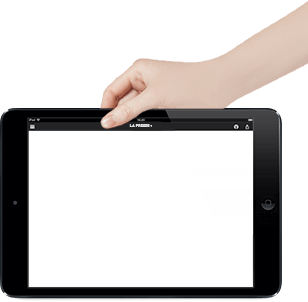Cinq fois moins de tarifs
L’un des facteurs de succès du futur train de la Caisse de dépôt est la simplification de la tarification dans la région de Montréal. À ce sujet, ai-je appris, deux scénarios sont privilégiés, qui diviseraient par cinq le nombre actuel de produits tarifaires du transport collectif.
Mes renseignements sont tirés du document confidentiel du 14 décembre auquel j’ai fait référence dans ma chronique du 1er février (« Une facture de 300 millions pour les Villes »). Une partie du document fait la synthèse des travaux réalisés depuis quatre ans par l’Agence métropolitaine de transport (AMT) concernant les tarifs.
D’abord, il faut rappeler qu’il y a environ 700 produits tarifaires différents dans la région de Montréal pour emprunter les transports en commun. Les usagers peuvent notamment payer pour un aller simple, une carte hebdomadaire ou une passe mensuelle. Les tarifs varient en fonction de la distance (huit zones). Ce capharnaüm ne favorise pas la hausse de l’achalandage.
Le document compare l’impact de quatre scénarios tarifaires sur le volume d’utilisateurs. Un scénario semblable à la situation actuelle (700 produits) est comparé à une intégration totale (10 produits tarifaires) et à deux scénarios mitoyens (de 110 à 150 produits tarifaires).
Selon l’analyse, il appert que les deux scénarios mitoyens sont à privilégier, puisqu’ils feraient augmenter significativement l’achalandage sans réduction globale des revenus.
Pour leurs simulations, faut-il savoir, les chercheurs ont tenu compte de l’effet d’une variation des tarifs sur le comportement des usagers. Grosso modo, il est reconnu dans l’industrie que chaque hausse de 10 % des tarifs fait reculer l’achalandage d’environ 3 %.
Cette élasticité-prix varie cependant selon le type de clientèle, expose le document. Ainsi, les usagers du train sont généralement peu sensibles aux variations de tarifs, tandis que ceux qui prennent surtout l’autobus le sont davantage. Plus la distance est courte, plus les utilisateurs sont sensibles aux variations de tarifs.
De plus, les usagers à destination du centre-ville changent moins leurs comportements après une hausse que ceux qui se dirigent plutôt vers la banlieue (probablement en raison des problèmes de stationnement au centre-ville).
Voyons les résultats. D’abord, le scénario avec 700 produits et trois zones tarifaires (plutôt que les huit actuelles) aurait pour effet d’accroître l’achalandage de seulement 0,5 %. Dans ce scénario, on conserve certains titres locaux et certains titres intégrés. Dit autrement, l’impact sur l’achalandage de ce scénario serait quasiment nul. À rejeter.
À l’autre extrême, le scénario avec une seule zone est pire, selon le compte rendu, même avec une intégration complète des organismes. Selon ce scénario, l’achalandage serait alors RÉDUIT de 1 %, est-il indiqué dans le document. Aux poubelles.
Les deux autres scénarios sont nettement plus intéressants. Dans les deux cas, il y aurait une intégration complète du réseau avec trois zones tarifaires, plutôt que huit. Ces trois zones seraient fonction soit de la distance à parcourir, soit des organismes de transport (STM, STL, etc.).
Autre élément important : les tarifs seraient plus élevés pour les usagers du train que pour ceux du duo autobus-métro. En revanche, les passagers du train auraient le droit d’utiliser sans frais additionnels le réseau d’autobus et de métro. Dit autrement, il y aurait en quelque sorte une passe bus-métro-train et une passe bus-métro pour chacune des trois zones.
Selon ce scénario, les organismes de transport bénéficieraient d’une augmentation de l’achalandage de 2,5 % tout en percevant globalement les mêmes recettes des usagers.
Enfin, le dernier scénario ajoute un palier tarifaire, soit les utilisateurs qui prennent seulement l’autobus. Dans ce cas s’ajouterait donc une troisième passe (bus, bus-métro, bus-métro-train).
Selon ce scénario, la refonte aurait pour effet d’augmenter l’achalandage d’environ 3,3 % avec les mêmes recettes globales des usagers. De plus, le nombre de produits tarifaires dans la région de Montréal serait divisé par cinq, passant de quelque 700 à environ 150.
Certains diront qu’une hausse de 3,3 % est relativement modeste. Il faut savoir que cette année, la croissance prévue de l’achalandage est de seulement 0,3 % pour les trains de banlieue.
Autre élément à considérer : plutôt que de miser sur une hausse de 3,3 %, les organismes de transport pourraient choisir de maintenir un achalandage constant et de miser sur une hausse de leurs revenus.
La refonte tarifaire entrerait progressivement en vigueur à partir du 1er juin 2018, prévoit le comité de transition de l’ARTM. La tarification serait pleinement intégrée à l’arrivée du REM, à la fin de 2020.
Tout indique que les futurs utilisateurs du REM devraient alors payer la passe plus musclée (autobus-métro-train). Le prix de ce titre de transport varierait en fonction des trois zones, selon la distance.
Le document ne donne pas de tarifs précis, mais les scénarios postulent que les variations de tarifs à la hausse ou à la baisse seraient modérées. Il est aussi envisagé que les tarifs soient plus bas hors pointe.
Avec la refonte, certains paieront plus, d’autres moins. Les usagers des territoires qui n’auront ni REM ni train, comme Châteauguay, pourraient donc payer moins.
Dans l’espace public, on entendra surtout les critiques des perdants de la refonte. Au bout du compte, toutefois, le constat est incontournable : les 700 produits tarifaires actuels nuisent au développement des transports collectifs.