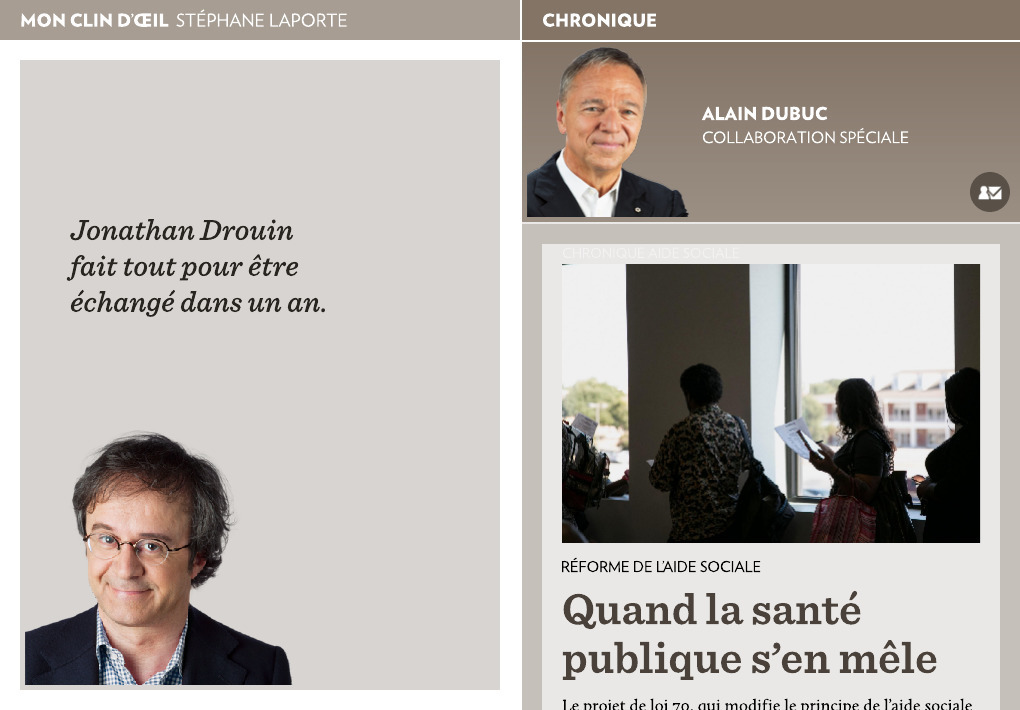Quand la santé publique s’en mêle
Le projet de loi 70, qui modifie le principe de l’aide sociale en introduisant un mécanisme de carotte et de bâton pour les nouveaux bénéficiaires, suscite, depuis des mois, un très vif débat. En fait, deux débats.
Le premier, social et économique, porte sur les avantages et les risques d’un système qui proposera des bonus à ceux qui accepteront de suivre un parcours d’intégration à l’emploi, mais qui réduira les prestations de ceux qui refusent.
L’autre débat, plus moral et idéologique, mené par des organismes communautaires et Québec solidaire, estime que l’aide de dernier recours est un droit inconditionnel, et s’oppose, par principe, à toute forme de contrainte tout en craignant que les mesures coercitives soient un symbole de stigmatisation.
Les directeurs de santé publique des régions de Montréal et de la Montérégie ont choisi de participer à ce débat, déposant un mémoire dont la principale recommandation, retirer du projet de loi le principe des pénalités, rejoint les thèses des mouvements militants.
En santé publique, il y a ceux qui veulent faire reposer leur participation aux débats publics sur une démarche scientifique dans les limites de leur champ d’expertise, et il y a ceux qui sont prêts à appuyer des mouvements sociaux dans l’atteinte d’objectifs qui leur paraissent souhaitables.
Ce mémoire s’inscrit dans ce deuxième courant, avec les risques que des opinions, aussi sincères et légitimes soient-elles, soient interprétées comme des faits probants résultant d’une démarche scientifique rigoureuse. C’est l’effet du sarrau, l’argument d’autorité : c’est vrai parce que des docteurs le disent.
Le mémoire de 47 pages comporte peu d’éléments susceptibles d’enrichir la discussion, parce que le gros du contenu est une réflexion générale sur la pauvreté et sur les liens entre pauvreté et santé. Il compte aussi neuf pages de références, sans doute pour donner du poids à l’exercice, mais dont la plupart ont un lien ténu avec le projet de loi, comme les facteurs périnataux influençant l’asthme en milieu préscolaire ou l’impact des CPE sur le taux d’emploi féminin.
Le biais militant, on le voit dans les procédés d’écriture. Le mémoire décrit les bonifications prévues comme « des allocations hebdomadaires de 38 $ à 60 $ ». Il décrit ainsi les pénalités : « Ces personnes verraient donc leur prestation de base amputée de 224 $, passant de 628 $ à 404 $ ». Au nom de l’équilibre, n’aurait-il pas été plus rigoureux de dire que les bonifications feraient passer la prestation mensuelle de 628 $ à 888 $ ? C’est un détail, mais il est révélateur.
De l’argumentaire, on retient trois éléments. D’abord une critique générale sur l’échec des programmes de « workfare » – où les gens doivent travailler pour obtenir leur aide sociale. Mais le projet de loi 70 n’est pas du « workfare », c’est un programme d’intégration à l’emploi qui comporte plusieurs volets en plus de la recherche d’emploi – accompagnement, études, acquisition d’habiletés.
Une inquiétude aussi sur le risque que des clients vulnérables soient pénalisés même s’ils ne sont pas aptes au travail – et donc pas assujettis au programme – à cause par exemple d’un accès difficile à un médecin pour les évaluer ou d’une faible littératie qui les empêche de bien composer avec l’administration. Des problèmes qui pourraient être résolus par de bons mécanismes d’accompagnement.
La santé publique s’inquiète aussi du fait qu’« un emploi de piètre qualité peut également contribuer à la dégradation de l’état de santé des personnes ».
Il est possible d’aborder ces questions avec rigueur. D’abord, il faut faire porter l’analyse sur la population visée. Ce ne sont pas tous les pauvres de Montréal ou les 412 000 bénéficiaires de l’aide sociale, mais les 17 000 nouveaux demandeurs d’aide sociale chaque année. On y compte des immigrants et des réfugiés, qui seront sans doute ravis de suivre un parcours et de voir leur prestation bonifiée. On y trouve surtout beaucoup de jeunes, qui ne sont pas fragilisés par des années d’exclusion et dont le potentiel d’insertion est bon.
Dans le cas des jeunes, les contraintes fonctionnent assez bien. À l’école, si on n’étudie pas, on coule. Si on ne se pointe pas à son travail, on n’est pas payés ou on peut perdre son job. Pourquoi l’imposition d’un cheminement, assorti d’une récompense, ne fonctionnerait-elle pas pour des jeunes tentés par l’aide sociale ?
Quant à l’argument des piètres emplois, il fait preuve d’angélisme. Encore là, il faut regarder les clientèles et rappeler que l’insertion sur le marché du travail est un cheminement, un apprentissage, qui commence souvent au bas de l’échelle. On le voit par exemple avec la prévalence du salaire minimum qui baisse à mesure que l’âge augmente.
Mais surtout, il faut appliquer un principe qui vaut pour toutes les politiques publiques, la balance des avantages et des effets indésirables.
Ce programme, très ciblé, réussira certainement à orienter des gens sur la voie du travail plutôt que celle de la dépendance.
Si la pauvreté a des effets négatifs sur la santé, la sortie de la pauvreté devrait avoir des effets positifs. On ne peut pas, dans une optique de santé publique, ne pas en tenir compte.