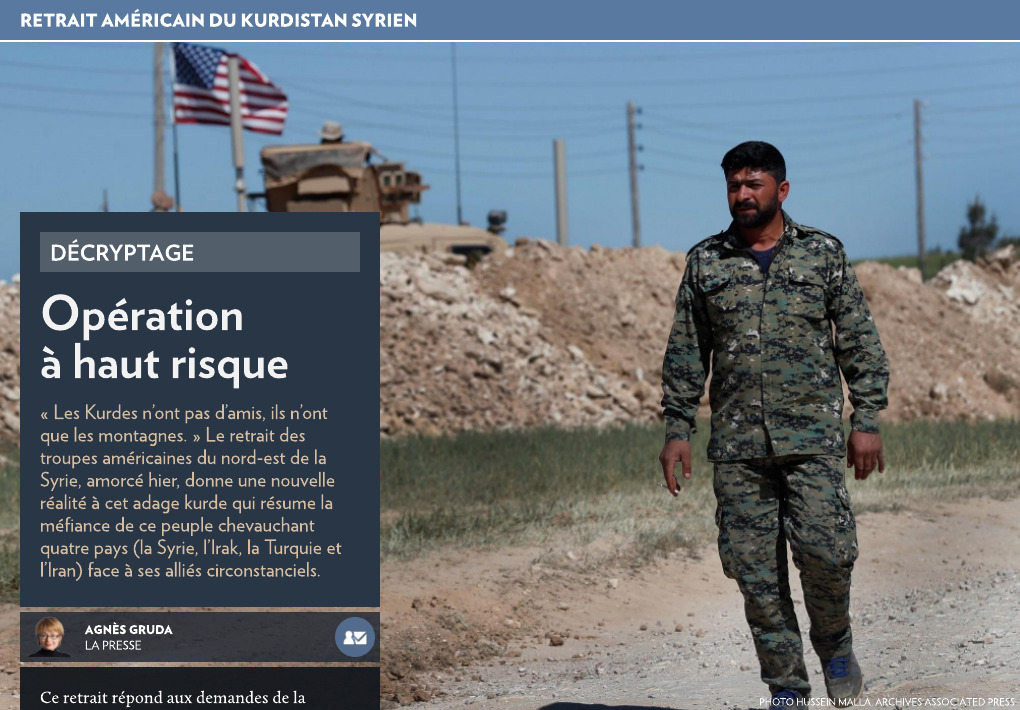Opération à haut risque
Ce retrait répond aux demandes de la Turquie, qui affirme vouloir créer un « corridor de sécurité » de 30 kilomètres sur 500, au-delà de sa frontière avec le Kurdistan syrien. Le départ américain ouvre la porte à cette offensive en territoire syrien qui paraissait imminente, hier.
Pour les Kurdes syriens qui ont combattu sur la ligne de front de la guerre contre le groupe État islamique (EI), ce retrait équivaut à une trahison.
Car ce sont les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) qui avaient réussi à freiner la progression des djihadistes, en les chassant d’abord de la ville de Kobané, en janvier 2015, tournant dans l’histoire de cette organisation terroriste, pour prendre le contrôle de leurs derniers retranchements, à Baghouz, en mars 2019.
Même si elles ont été aidées par les avions de la coalition internationale anti-EI, les milices kurdes ont été sur la ligne de front pendant plus de quatre ans.
Et elles ont perdu plus de 10 000 combattants dans cette guerre.
À peine sept mois après cette ultime défaite, les principaux alliés occidentaux des Kurdes viennent de les abandonner, les livrant en pâture à la Turquie qui les considère comme des terroristes liés à ses propres séparatistes kurdes.
Même Kobané, ville-symbole où s’est amorcé le déclin de l’EI en Syrie, qui est contrôlée depuis janvier 2015 par les autorités civiles kurdes, risque désormais de tomber sous contrôle turc.
Décision irresponsable
On peut déplorer le cynisme de cette décision d’un point de vue moral. Mais elle risque aussi d’avoir des répercussions contraires aux intérêts… de Washington. Pas étonnant que des voix se soient élevées dans l’entourage de Donald Trump dès qu’il a annoncé son intention de retirer l’armée américaine « des guerres ridicules interminables ».
La critique la plus significative est venue du sénateur Lindsey Graham, l’un des plus proches partisans du président Trump, qui lui a reproché cette décision « irresponsable et à courte vue ».
« Laisser nos alliés mourir est une grosse erreur », a renchéri l’ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU Nikki Haley.
Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, lui aussi un allié fidèle de Donald Trump, a quant à lui averti qu’un « retrait précipité des forces américaines de Syrie tournerait à l’avantage de la Russie, de l’Iran et du régime de Bachar al-Assad ».
Abandonnées par les Américains, les Forces démocratiques syriennes, coalition militaire dominée par les YPG, vont vraisemblablement se tourner vers Moscou, selon Vahid Yücesoy, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie rattaché au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal.
Selon lui, les premiers perdants de ce retrait seront les États-Unis eux-mêmes, puisqu’ils s’infligeront une perte d’influence dans cette zone ultra-sensible, « laissant le terrain libre aux Russes, mais aussi à la Chine et à l’Iran ».
Ce retrait risque aussi de faire éclater les Forces démocratiques syriennes et de laisser exploser les tensions entre les milices kurdes et arabes, jusque-là alliées contre l’EI.
Au cours des dernières années, les autorités kurdes qui exerçaient une certaine autonomie sur leur territoire syrien ont été accusées de vouloir chasser les populations arabes. Amnistie internationale est allée jusqu’à évoquer le spectre d’un « nettoyage ethnique » alors que des villages arabes du Kurdistan syrien étaient abandonnés par leurs habitants.
« Compte tenu des réalités ethniques et des tendances du conflit, les milices arabes au sein des FDS ne voudront pas se ranger derrière les Kurdes face à l’armée turque », prévoyait Fabrice Balanche, spécialiste de la région, dans un article publié par le Washington Institute for Near East Policy en décembre dernier – au moment où la possibilité du départ américain venait d’être évoquée pour la première fois.
Une partie des Arabes établis au Kurdistan syrien pourraient s’allier avec la Turquie, renchérit Vahid Yücesoy. Ce qui ouvrirait potentiellement un nouveau front après huit ans de guerre civile en Syrie.
Le risque de l’EI
Mais le retrait américain soulève une autre inconnue : qu’arrivera-t-il avec les 70 000 djihadistes et leurs proches actuellement détenus dans des camps et des prisons sous contrôle kurde ? Un groupe qui inclut quelques milliers de combattants étrangers – dont une trentaine de Canadiens.
La Turquie a annoncé son intention de renvoyer ces prisonniers vers leurs pays d’origine respectifs – qui n’en veulent pas. En cas d’embrasement régional, ces prisonniers pourraient aussi se retrouver en liberté, pour éventuellement reprendre le flambeau du djihad…
Ankara aimerait aussi profiter de cette offensive pour caser dans la région 1 million des 5 millions de réfugiés syriens actuellement établis en Turquie, un déplacement humain potentiellement explosif.
Mais que cherche donc le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, avec cette incursion à haut risque ? Principalement à redorer son blason passablement terni en Turquie, répond Vahid Yücesoy.
Le parti d’Erdoğan a perdu les élections municipales d’Istanbul en juin, sa popularité décline, ses plus proches alliés se distancient de lui et songent à fonder leur propre parti.
Or, son plan d’intervention contre les Kurdes syriens, tout comme son projet de retourner 1 million de réfugiés en Syrie, est très populaire auprès des électeurs turcs.
En d’autres mots, le projet d’offensive en territoire syrien répond à des impératifs de politique interne : « Erdoğan a besoin d’un nouveau souffle », note Vahid Yücesoy.
Projet devenu réalisable grâce au retrait annoncé par Donald Trump.