Mon clin d’oeil Samedi
Le SPVM va changer de culture, les policiers porteront maintenant des collants de ballet et des tutus.
Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 1 avril 2017,
section DÉBATS, écran 7


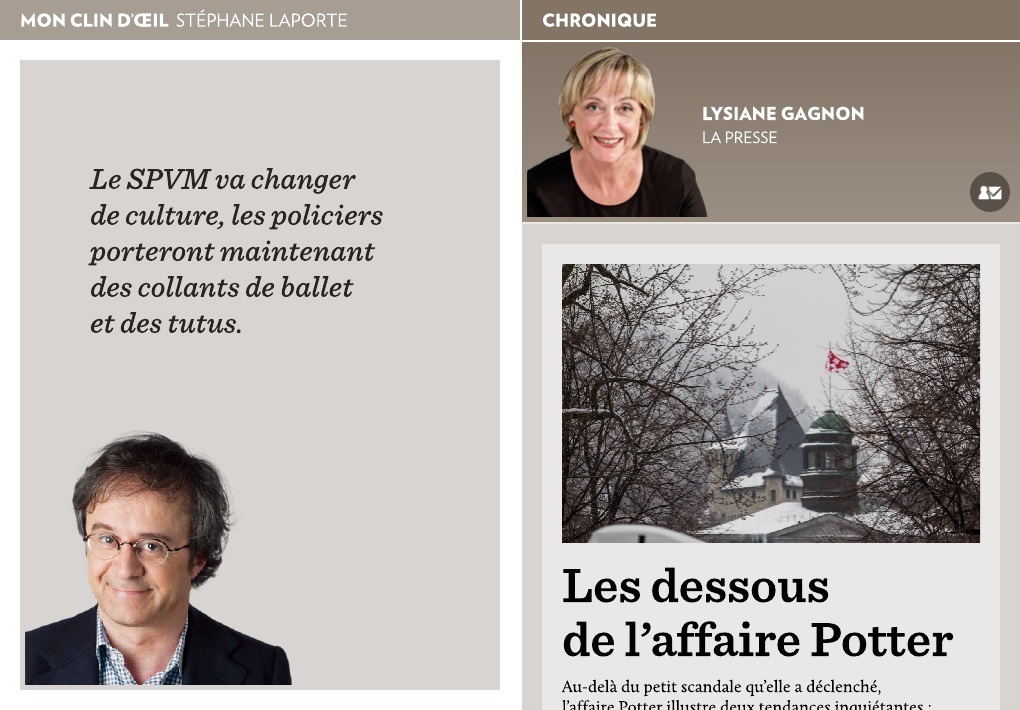
Le SPVM va changer de culture, les policiers porteront maintenant des collants de ballet et des tutus.
Au-delà du petit scandale qu’elle a déclenché, l’affaire Potter illustre deux tendances inquiétantes : le dépérissement des normes journalistiques dans une presse traditionnelle acculée à la faillite, de même que l’abaissement du niveau de la recherche dans des universités privées de fonds.
Il y a fort à penser qu’un article comme celui qu’a signé Andrew Potter sur le Québec n’aurait pas été publié sans modifications substantielles à l’époque où le magazine Maclean’s était relativement prospère. Un éditeur ou un réviseur aurait appuyé sur le bouton rouge devant un pareil brûlot.
Or, après un demi-siècle d’existence comme hebdomadaire, Maclean’s est devenu un mensuel qui lutte pour sa survie, accroché à la bouée d’un site web. Son propriétaire, Rogers Media, vient d’y couper 13 postes, après s’être débarrassé de son équivalent francophone, L’actualité, et fait subir la même cure d’amaigrissement extrême à Châtelaine.
On devine la suite : moins de personnel à la rédaction, des réviseurs débordés, des éditeurs inexpérimentés désespérément soucieux de faire augmenter le tirage à coup de raccourcis sensationnalistes.
Cela veut dire aussi que faute de budget pour rémunérer des journalistes professionels, les publications qui n’ont pas pris à temps le virage technologique s’en remettent de plus en plus à des non-journalistes pour commenter gratuitement l’actualité.
Par exemple, des représentants de groupes de pression, des anciens politiciens ou des fonctionnaires à la retraite… ou encore, des universitaires qui gagnent bien leur vie dans l’enseignement et accepteront de se passer d’honoraires pour se bâtir une réputation dans le grand public.
Parenthèse : on me dira que Maclean’s, même au temps des vaches grasses, faisait dans le « Quebec bashing » – à preuve, cette fameuse manchette décrivant le Québec comme « la province la plus corrompue ».
Relativisons. Cette manchette était discutable, et la comparaison avec le reste du Canada, inutilement vexante.
Mais le contenu de l’article n’avait rien à voir avec les élucubrations de M. Potter. Son auteur, Martin Patriquin, journaliste de métier qui était le correspondant du magazine au Québec (son poste vient d’être aboli à la suite des compressions budgétaires), avait très correctement décrit la situation qui allait mener à la création de la commission Charbonneau et à l’inculpation de nombreux politiciens.
L’autre phénomène qu’illustre l’affaire Potter est la tendance grandissante des universités à privilégier la présence médiatique, au détriment du travail lent, méthodique et largement invisible qu’exige la recherche universitaire.
Comme l’expliquait cette semaine dans Le Devoir l’historien Yves Gingras, de l’UQAM, les universités, « à court de subventions gouvernementales permettant d’assurer une recherche rigoureuse et indépendante, se tournent vers des bailleurs de fonds privés. Pour les attirer, elles cherchent à accroître leur visibilité médiatique ».
C’est en partie la raison qui avait poussé McGill à choisir M. Potter pour diriger son Institut d’études canadiennes. Ancien professeur de philosophie et auteur d’essais respectés, M. Potter avait une indéniable crédibilité dans le milieu universitaire, mais ces dernières années, il s’était orienté vers les médias.
En annonçant sa nomination, McGill se réjouissait d’avoir mis la main sur un « commentateur » doté d’« une visibilité nationale » et d’« une réputation comme intellectuel public », qui avait en outre « l’atout majeur » d’avoir été rédacteur en chef du Ottawa Citizen.
Dans le Globe and Mail, Éric Montpetit, politologue à l’Université de Montréal, vient à son tour de signaler la tendance des universités à rechercher la visibilité médiatique pour combattre le préjugé voulant que la recherche universitaire soit un phénomène élitiste sans utilité pour la société. (Les universités craignent en effet que ce genre d’argument démagogique incite les gouvernements à diminuer les subventions de recherche.)
Or, ce faisant, les universités risquent de « miner leur propre crédibilité » et de « contrevenir à leur mission, qui est de produire du savoir validé par la recherche », écrit M. Montpetit.
Dans leur quête désespérée du soutien populaire, les universités voient d’un bon oeil que leurs professeurs commentent l’actualité à chaud, dans des articles vite faits pour des médias de masse, ou qu’ils participent à des émissions grand public… au risque que certains – comme Andrew Potter justement – se trouvent piégés par la facilité, en pondant des chroniques d’humeur qui nuiront à leur crédibilité comme chercheurs.
M. Potter a même trouvé normal de signer son brûlot de son titre de directeur d’un institut de recherche. Outre qu’il s’agit d’un surprenant manque de jugement, cela en dit long sur le climat qui règne dans des universités prêtes à subordonner leur principale raison d’être – l’avancement de la recherche – aux feux éphémères de la visibilité médiatique.
