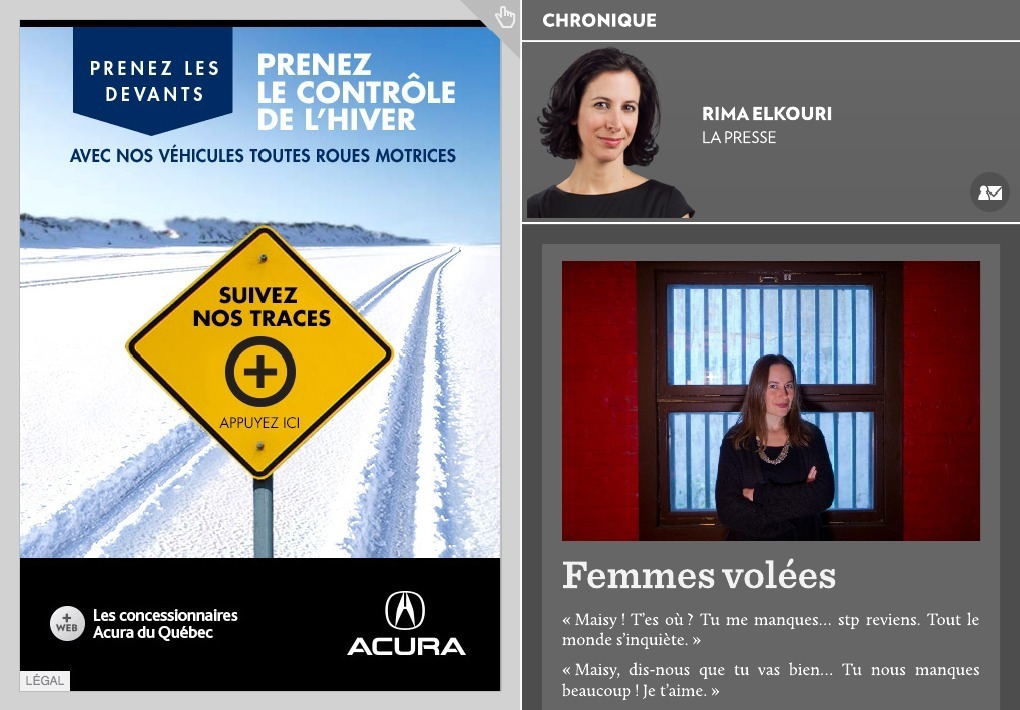Chronique
Femmes volées
La Presse
« Maisy ! T’es où ? Tu me manques… stp reviens. Tout le monde s’inquiète. »
« Maisy, dis-nous que tu vas bien… Tu nous manques beaucoup ! Je t’aime. »
Ces messages et des dizaines d’autres au ton de plus en plus désespéré ont été envoyés sur le mur Facebook de Maisy Odjick dans les jours qui ont suivi sa disparition, le 6 septembre 2008. Ils sont cités dans (Lux, 2014), l’enquête bouleversante menée par la journaliste Emmanuelle Walter, hantée par le sort des 1200 femmes autochtones assassinées ou disparues au Canada depuis 1980.
Mille deux cents. Le chiffre obèse fait frémir. La réalité effroyable qu’il englobe, encore plus. Toutes proportions gardées, c’est comme si 7000 Québécoises avaient disparu dans l’indifférence, sans que l’État se décide à prendre les grands moyens pour mettre fin à l’horreur.
Sous la plume d’Emmanuelle Walter, la tragédie prend corps. Les femmes autochtones disparues ne sont plus des statistiques anonymes. Ce sont des filles, des sœurs, des voisines. C’est une petite-fille qui avait l’habitude de laisser à sa grand-mère des petits mots sur la table, désormais gardés précieusement dans un tiroir. « Je suis encore sortie. Je t’appelle plus tard. Je t’aime. Maisy. »
Cette même Maisy, 16 ans, de Maniwaki, qui ne répond plus à ses messages Facebook depuis ce jour de septembre où elle a été vue portant une jupe et un chemisier à manches courtes. Son amie Shannon Alexander, 17 ans, a disparu le même jour sans laisser de traces. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des souliers de course blanc et rouge de marque Asics.
Elles avaient des rêves et des ambitions. Maisy, passionnée de dessin, voulait devenir styliste. Shannon allait devenir infirmière. Deux belles grandes adolescentes qui avaient la vie devant elles et dont les proches, dans l’indifférence ou presque, remuent mer et monde afin de les retrouver. Deux parmi 1200 qui ont disparu en laissant derrière elles des larmes et de l’indignation. Où sont-elles ?
Dans son enquête, Emmanuelle Walter plonge sa plume dans la plaie béante de ce qu’elle appelle « un féminicide à bas bruit » prenant sa source dans la réalité coloniale. « Quand des femmes meurent par centaines pour l’unique raison qu’elles sont des femmes et que la violence qui s’exerce contre elles n’est pas seulement le fait de leurs assassins mais aussi d’un système ; lorsque cette violence relève aussi de la négligence gouvernementale, on appelle ça un féminicide », écrit-elle d’entrée de jeu.
Longtemps, on a voulu réduire ces disparitions à une succession d’incidents isolés dans des communautés où l’on s’autodétruit, rappelle la journaliste. En 2004, un rapport d’Amnistie internationale intitulé a renversé la perspective. Bien sûr qu’on pouvait individualiser chaque meurtre ou chaque disparition. Mais on ne pouvait plus nier que l’on était devant une véritable tragédie en matière de droits de la personne. On ne pouvait plus nier les carences d’un système qui acceptait sans rien dire que des femmes et des filles autochtones n’aient pas droit à la même protection des autorités canadiennes que tous les autres citoyens dignes de ce nom.
Comment un pays démocratique comme le Canada peut-il fermer les yeux sur un tel scandale ?
Cela fait des années que des voix s’élèvent pour exiger une enquête nationale sur les femmes autochtones tuées ou disparues. Cette semaine, à l’occasion des Marches de la mémoire organisées depuis 1991 tous les 14 février en hommage aux femmes disparues, d’autres voix se feront encore entendre. Jusqu’ici, le gouvernement Harper, insensible au sort de ces filles invisibles, leur offre toujours la même réponse honteuse : non.
Un des témoignages les plus troublants et les plus évocateurs dans le livre d’Emmanuelle Walter est celui de Connie Greyeyes, une autochtone de Colombie-Britannique qui, à elle seule, connaît 11 femmes de son entourage disparues ou assassinées. Pas une, ni deux, mais 11 de ses amies, voisines, tantes, cousines… Sur la colline du Parlement, dans le vide et l’indifférence, elle a raconté son histoire. En l’écoutant, la journaliste a eu l’impression d’entendre une femme vivant dans un pays en guerre.
Ce jour-là, Connie Greyeyes a conclu son discours en citant un texte poignant écrit par la jeune poétesse Helen Knott qui rend hommage aux femmes disparues et dénonce l’indifférence entourant leur sort. Connie Greyeyes a choisi d’interpeler directement le premier ministre.
EXTRAITS CHOISIS :
« C’est étrange que tu ne réussisses pas
à me voir
quand je suis
couchée sur le dos, les lèvres boursouflées,
le corps gonflé et battu,
meurtri, méconnaissable.
Je n’attire toujours pas ton attention ? […]
Est-ce que j’entre dans ton champ de vision
Me vois-tu maintenant, Stephen Harper ?
Parce que j’ai l’impression
Que tes yeux
Font une courbe
Autour de moi. »
En octobre 2013, Connie Greyeyes a lu l’intégralité de ce poème devant le comité parlementaire spécial chargé d’étudier la violence faite aux femmes autochtones. Mais dans le rapport final du comité, qui s’ouvre avec ce texte, Emmanuelle Walter a découvert « une petite censure, discrète, mais significative ». La question « Me vois-tu maintenant ? » y est immédiatement suivie d’un point d’interrogation.
Le nom du premier ministre avait disparu. Tout comme la recommandation du rapport préliminaire, qui exigeait la tenue d’une enquête publique. Comme si on avait voulu dire à ces femmes invisibles que leur impression était juste. Des yeux glissent sur elles sans les voir.
LE SCANDALE EN BREF
1181 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées entre 1980 et 2012.
En 2012, les femmes autochtones représentaient 23 % des femmes victimes d’homicides alors qu’elles ne constituent que 4 % des femmes au Canada.
En 1980, les femmes autochtones représentaient 9 % des femmes victimes d’homicides au Canada.
Le nombre de meurtres de femmes diminue au pays, mais pas pour les femmes autochtones.
Sources : GRC, Sœurs volées : (Lux 2014)