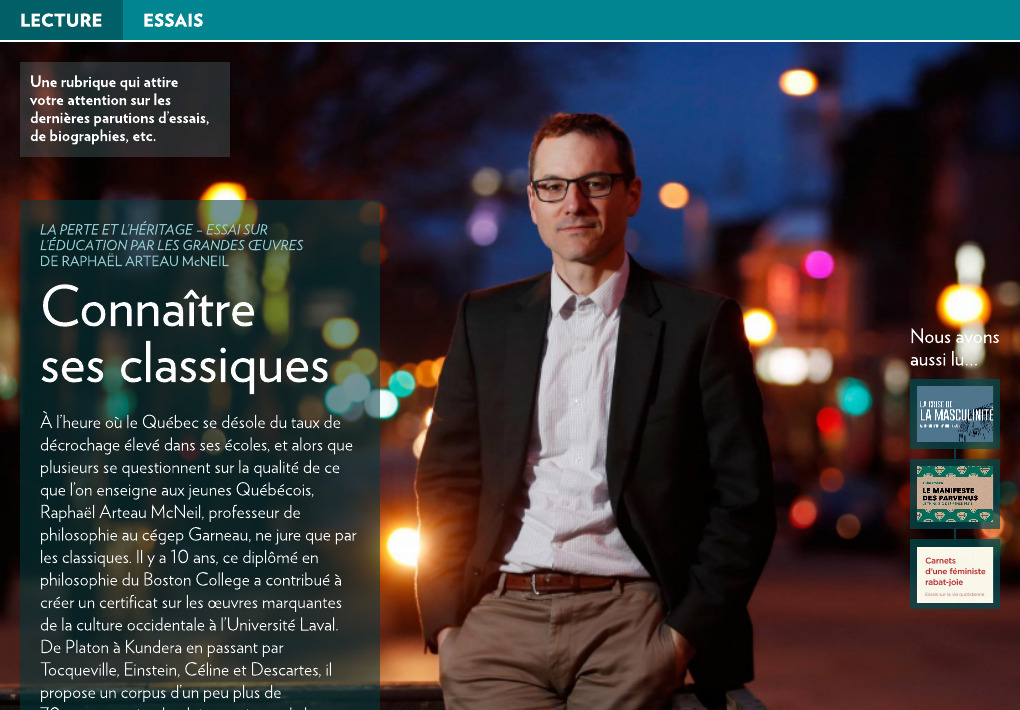Connaître ses classiques
Quelle est la genèse de ce certificat d’enseignement par les grandes œuvres ?
J’ai étudié au Boston College et aux États-Unis, il y a une tradition de Great Books College, des lieux d’enseignement des grandes œuvres de la culture occidentale. Au Québec, le seul équivalent serait le Liberal Arts College de l’Université Concordia. Étudiant au cégep, j’avais moi-même apprécié que certains profs organisent des groupes de discussion autour de livres ou de textes au programme. Devenu professeur à mon tour, j’ai constaté à quel point les jeunes n’avaient plus de références communes. On peut croiser un étudiant spécialisé dans les combats militaires de la Seconde Guerre mondiale ou un autre qui aura tout lu Flaubert, mais entre ces deux pôles, il y a très peu de culture commune.
Est-ce un constat d’échec de notre système d’éducation ?
Je fais un constat dur et sévère quand je parle d’une génération de déshérités. Et je m’inclus là-dedans. Quand je suis sorti du cégep, il me manquait des références, une vision large de l’histoire. Notre système d’éducation vise avant tout à apprendre un métier ou une profession, c’est un système spécialisé. L’école, pour des raisons qui s’expliquent, a abandonné la grande culture. Aujourd’hui, l’élève peut très bien faire un travail sur Hamlet ou sur Le roi lion de Disney, l’école ne fait plus la distinction entre les deux. On laisse les jeunes choisir selon leur intérêt, ils sont libres de leur apprentissage. Je le sais, j’ai quatre enfants. Et ils ont vu Le roi lion qui est un très bon film. Mais il n’a pas sa place à l’école. Le résultat, c’est que la culture commune s’effrite. Seuls les jeunes qui grandissent dans des milieux où la culture est valorisée s’en réchappent. Alors oui, c’est un constat d’échec.
Pourquoi un retour aux classiques ?
Je crois important de refaire le lien avec la grande tradition, de revoir les grandes œuvres de philo, de littérature, de science, d’histoire et de religion qui ont ponctué l’histoire. L’objectif est à la fois pour se mettre en clair avec soi-même, apprendre à se connaître, à réfléchir et pour sortir de nous-mêmes aussi. Et de la culture de la consommation ambiante. Il y a un plaisir à discuter des textes et des œuvres et à ne pas considérer l’éducation d’un seul point de vue utilitaire. Je ne veux surtout pas retourner au cours classique qui était élitiste et réservé à un petit groupe, surtout des hommes. Mais en voulant démocratiser l’éducation et en voulant rompre avec l’élitisme, on a jeté le bébé avec l’eau du bain. Qu’on ait voulu en finir avec l’autoritarisme, le sexisme et le racisme, j’en suis, mais on aurait pu conserver les grands textes. Et les rendre accessibles à tous.
Comment détermine-t-on une grande œuvre ?
Essentiellement, ce sont les œuvres qui ont marqué leur époque. C’est basé sur un fait historique.
On compte seulement 4 femmes sur la liste de 71 œuvres suggérées à la fin de votre livre : Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Jane Austen et Madame de Lafayette. C’est peu, non ? Où sont les Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, Simone Weil, Toni Morisson, pour ne nommer que les plus évidentes ?
C’est vrai, les grandes œuvres sont essentiellement écrites par des hommes blancs. Mais historiquement, il y avait plus d’hommes que de femmes qui écrivaient et publiaient. Prenons l’époque de Platon. Est-ce qu’il y avait des femmes ? Sûrement, mais on ne les connaît pas. Et j’ajouterais que Platon ne m’intéresse pas parce qu’il est un homme. Et aucun de ces auteurs sur la liste n’a été choisi parce qu’il était un homme. Ils ont été choisis parce qu’ils ont écrit le meilleur livre. Tout comme j’ai choisi un livre de Hannah Arendt sur la révolution. Ce serait triste de se priver d’Homère parce qu’il est un homme…
Sans s’en priver, n’y a-t-il pas un effort à faire pour rétablir un certain équilibre ? Il y a quand même eu un travail de défrichage en histoire et en littérature au cours des dernières années qui a permis de mettre en valeur plusieurs œuvres de femmes…
La grande tentation serait de s’excuser, mais en même temps, si je faisais cela, j’abdiquerais alors que je demeure convaincu qu’il faut garder cette tradition et combattre le relativisme ambiant. Dans le cadre du certificat, il y a un cours où les étudiants choisissent l’auteur qu’ils souhaitent étudier. Par le passé, j’ai eu des étudiantes qui ont choisi des femmes : Marguerite Yourcenar, Sylvia Plath… Aussi, dans chaque cours, on discute de la place des femmes. Mais si on veut découvrir des textes de femmes, il y a les études féministes pour ça.
Dans certaines universités, on va jusqu’à réclamer le retrait de textes qui pourraient être perturbants ou offensants pour certains étudiants. Avez-vous l’impression d’être en porte-à-faux avec l’époque ?
Oui, je comprends très bien qu’on veuille condamner toute action répréhensible, mais là, on parle d’œuvres, pas de gens. Je n’ai pas l’impression de faire le poids contre ce mouvement, mais ma grande crainte, c’est que plus on retirera des œuvres, plus on risque d’être ignorants.
La perte et l’héritage – Essai sur l’éducation par les grandes œuvres
Raphaël Arteau McNeil
Boréal
173 pages