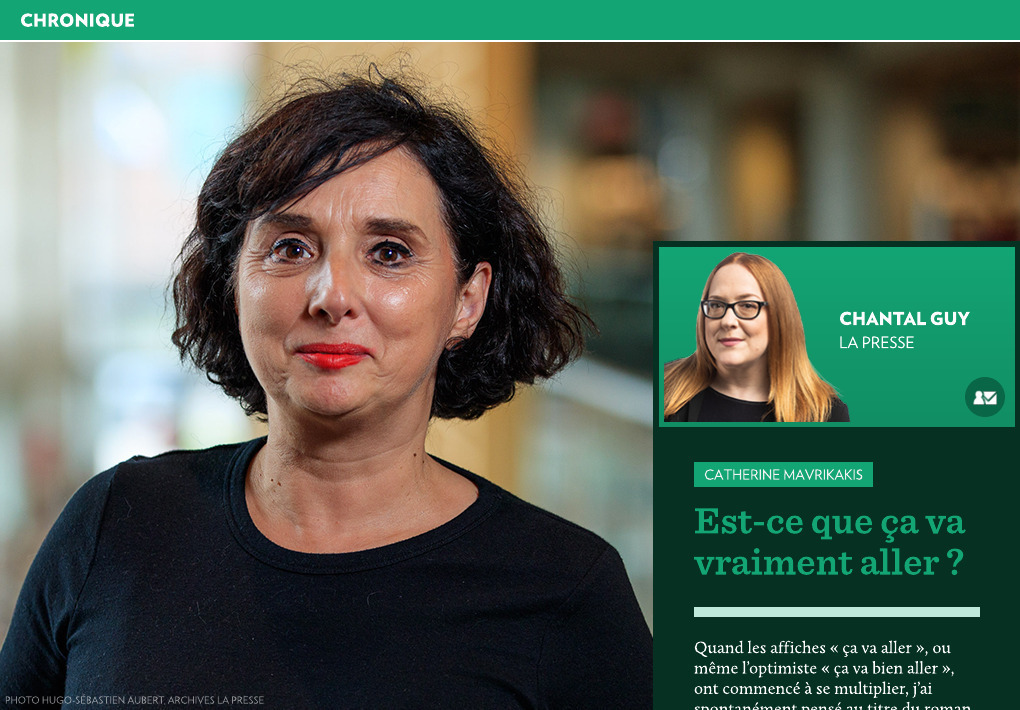Est-ce que ça va vraiment aller ?
Quand les affiches « ça va aller », ou même l’optimiste « ça va bien aller », ont commencé à se multiplier, j’ai spontanément pensé au titre du roman de Catherine Mavrikakis, Ça va aller, paru en 2002. Ce qui fait sourire, car Mavrikakis a une vision de la vie plutôt pessimiste, voire désespérée parfois – et c’est comme ça qu’on l’aime, d’ailleurs. Je suis sa carrière depuis le début et j’ai lu tous ses livres.
Catherine Mavrikakis est un peu une écrivaine de la catastrophe. Qu’il s’agisse du sida dans Deuils cannibales et mélancoliques, de la Seconde Guerre mondiale dans Le ciel de Bay City, d’Anne Frank dans L’annexe et même d’une épidémie mortelle qui ravage Montréal dans Oscar de Profundis, ses romans nous amènent à penser comment on passe au travers, comment on vit avec la catastrophe, comment on hérite des traumatismes.
Un bon prétexte pour piquer une jasette avec l’une des écrivaines les plus influentes du Québec, qui insiste pour donner ses cours à distance à ses étudiants – « car il faut montrer qu’on est encore là, les adultes », dit-elle.
Connaissant ton œuvre, j’ai envie de savoir ce que tu penses de ce qui arrive avec cette pandémie.
« Je trouve qu’on dit beaucoup de choses et qu’on devrait suspendre son jugement en ce moment. Mais on ne peut pas s’empêcher de penser, et c’est bien de penser aussi. C’est sûr qu’on va dire plein de bêtises. Mais ce n’est pas grave, il faut les dire, ces bêtises, et puis il y a des choses intelligentes qui vont sortir de tout ça. Il faut se permettre l’erreur, je crois. On ne sait pas dans quel sens vont les choses ni le sens des choses… Mais il y a des gens qui meurent, c’est ça qui est terrible. »
Tu as beaucoup travaillé sur les notions de maladie, de virus, sur le philosophe Michel Foucault… comment vis-tu ça ?
« Je suis confinée, j’accepte tout ça, mais je m’interroge sur tous les gens qui, dans les pandémies, se sont posé des questions comme Michel Foucault, sur la place de l’État et la place de cette obéissance liée au pouvoir que nous avons, comme il le pensait. Il y a eu un texte de Giorgio Agamben dans Le Monde, très foucaldien, il était très inquiet, trouvant que l’État prend énormément de place en ce moment. Nous sommes tous en train d’accepter des choses, de renoncer à des droits, comme si de rien n’était, pour la sécurité de nos corps, mais qu’en est-il de la sécurité de nos âmes ? Il pense à la notion d’exception qu’on est en train de créer et comment l’État reprend cette idée d’exception. Comment va-t-on retrouver un État de droit et non plus un état d’exception ? C’est une vraie question, et l’autre jour, une phrase de Legault m’a un peu angoissée. Lorsqu’il a dit qu’il faut faire confiance aux policiers, à leur jugement. Heu… oui et non. D’ailleurs, si j’étais policier, je ne sais pas si j’aurais envie que ce soit moi qui exerce le jugement. Faire obéir aux lois, ce n’est pas de juger les gens. Tout le monde est laissé à soi-même et doit presque devenir philosophe. Là, il y a juste une loi : il faut se laver les mains et ne pas se toucher. Je ne sais pas trop par contre si le modèle de Foucault ou d’Agamben fonctionne encore. Mais moi, qui ai été élevée comme une intellectuelle dans ce monde, c’est sûr que j’ai des réflexes de vieille conne et je me pose des questions sur la place de l’État ! [rires] »
[Rires] Ben là, Catherine !
« Et puis l’autre jour, j’entendais les cloches. Je n’ai rien contre, j’aime beaucoup les églises, mais toutes les cloches qui sonnent un dimanche alors que tout est fermé, c’est quoi, ce retour… à quoi ? Pourquoi pas la dîme le mardi ? J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui se met en place qu’on accepte parce qu’on retourne à des choses très anciennes chez nous. Le dimanche est une journée presque sacrée pour les chrétiens, mais est-ce que ça correspond à notre société encore ? J’ai l’impression qu’on fait un peu des choses sans trop savoir ce qu’on fait. »
Tu as écrit des textes puissants sur le sida. En ce qui concerne la transmission du virus, des morts qui s’accumulent, comment vois-tu ça ?
« Je vois qu’on est en train de vivre une blessure narcissique en Occident, dans les pays industrialisés. On a toujours cru que la mort était loin et justement, elle n’est pas loin, elle est dans le gymnase à côté. On avait toujours des rites pour oublier la mort, pour la mettre un peu plus loin, à l’extérieur de la ville, dans les cimetières. Alors qu’il y a longtemps, ils étaient dans la ville. Pour les littéraires, on a vu ça dans les livres. Je pense à la nouvelle Le masque de la mort rouge, d’Edgar Allan Poe, où tout le monde meurt. Cette mort, nous, on la « scientifie ». On dirait que quelque chose de l’horreur de la mort nous réapparaît. Et puis d’un ennemi qu’on ne voit pas. On a beau faire toutes les métaphores de la guerre, c’est ce qu’il y avait au début du sida, mais ça a vite changé parce qu’on s’est aperçu que ce n’était pas une guerre, l’ennemi était beaucoup plus complexe que si c’était une simple guerre. Dans nos psychés, on a l’impression que le virus est partout dans nos rapports entre nous, comme pour le sida, mais le sida était beaucoup plus dans la sexualité. Là, c’est tout le temps. J’ai l’impression que même nos corps, on va les repenser. »
Il y a une menace qu’on avait oubliée, mais qui était là dans le passé.
« Je pense beaucoup à ma mère qui est morte l’an dernier, qui avait vécu la guerre. À mon grand-père qui avait été terrassé par la grippe espagnole en 1918. Je pense à ces gens-là qui, eux, ont vécu des choses. Ma mère était très traumatisée par le passé. Notre génération, on a eu l’impression qu’il n’arriverait jamais quelque chose comme ça. Tu vas rire, mais j’étais très contente de voir la reine d’Angleterre à la télévision l’autre jour. Pas que je suis une fan, mais j’étais contente parce qu’il y avait une vieille dame qui avait traversé l’Histoire. Je trouve qu’en ce moment, au Québec, dans notre rapport aux aînés, on ne les laisse pas parler. Il faut les protéger, on les met en quarantaine, mais j’ai l’impression que ces gens-là qui ont vécu des choses difficiles, des catastrophes, on n’apprend rien de leur expérience en ce moment. Il y a quelque chose que je n’aime pas qui se passe par rapport à l’expérience des anciens, comme si on voulait dire que pour nous, c’est différent. Il y a dans le vieillissement une sagesse avec laquelle on a complètement coupé. Moi, ça me choque. J’aurais besoin de cette parole-là, alors que les aînés, on les traite mal. Je sais qu’on veut les sauver, mais ils ne sont pas sur la scène pour raconter des choses dont on aurait absolument besoin. Qui peuvent nous dire : voyez, je suis là. »
Ton roman apocalyptique Oscar de Profundis te revient-il en ce moment ?
« Oui, beaucoup. Surtout quand je vois qu’à New York, ce sont les gens les plus pauvres qui sont en train de mourir. Dans ce roman, il y avait deux catégories de personnes. Celui qui s’enferme dans la culture, Oscar de Profundis, qui voit ça de très loin parce qu’il est confiné et peut l’être, et il y a les sans-abri qui ne peuvent pas être confinés et qui vont en mourir.
« En ce moment, même si nous sommes tous susceptibles d’attraper la maladie, les classes sociales sont encore plus fortes. Quelqu’un comme moi, qui suis privilégiée, ce n’est pas si difficile d’être confinée. D’une certaine façon, j’ai appris toute ma vie à l’être. Je lis, j’écris, je suis chez moi, alors qu’il y a des gens qui vont travailler, ou qui doivent rester à la maison et qui ne sont pas habitués à ça, psychologiquement. C’est bien beau de dire qu’il faut lire des livres pendant le confinement, mais si tu n’as jamais lu de livres, tu ne vas pas en lire plus maintenant. Pour des gens, c’est la catastrophe, la peur de ne pas avoir d’argent demain, les entreprises qui vont tomber. Il y a des dommages collatéraux qui sont énormes. »
L’annexe paru l’automne dernier est un peu un roman du confinement avant la lettre. Tu y parles d’Anne Frank et on ne pouvait pas être plus confiné qu’elle et sa famille.
« Encore là, je me sens très privilégiée. Je suis devant ma fenêtre, je vois les gens qui marchent dehors. Anne Frank n’est pas allée se promener pendant plus de deux ans. Ils étaient huit dans un espace extrêmement petit. Elle n’avait pas la peur d’un virus qui ne frappe pas tant que ça ; elle, elle avait peur à chaque moment que quelqu’un arrive et les rafle. Je pense aussi qu’on est en train d’oublier dans le monde des situations, comme en Palestine ou en Syrie, où ce n’est pas évident de vivre. D’avoir peur tout le temps. Nous avons oublié la peur. »
Que peut-on apprendre en lisant Le journal d’Anne Frank ?
« Même si elle va terriblement souffrir après, c’est l’espoir chez Anne Frank. C’est-à-dire qu’elle continue de rêver, elle aspire à quand elle va sortir, elle note des moments qui sont heureux dans la journée, elle essaie de garder ça comme une espèce de collection de pierres précieuses. Elle rêve d’un après, et ça, c’est important, la part du rêve. Elle est aussi capable d’apprécier ce qui se passe dans cette petite maison assez horrible où elle n’a pas de place. Comme si elle arrivait à créer un monde intérieur. Et ça, je pense que c’est important.
Comment va l’inspiration, pour toi, comme écrivaine ?
« J’ai envie d’écrire, mais sur autre chose. En ce moment, c’est comme si la fiction dépassait la réalité, hein. L’histoire est plus puissante que nous, c’est à elle de parler et de dire son dernier mot. L’Histoire n’a pas besoin de moi en ce moment. »
Je sais que tu es une personne anxieuse, pessimiste parfois, mais je pense que les gens comme ça sont mieux faits pour passer au travers d’un évènement comme celui qui nous arrive.
« Je le pense aussi. Je sens ça beaucoup. Avec mon espèce de pessimisme, je suis toujours en crise ! [rires] Ce que disent beaucoup de gens déprimés et anxieux est que lorsqu’on ne va pas bien quand le monde va bien – ce n’est pas qu’on veut qu’il aille mal –, ça nous rend encore plus différents. Là, j’ai l’impression que nous sommes une communauté d’anxieux. Ça a l’air bizarre, mais je me sens moins seule. On se sent moins marginal quand les gens vivent la même chose que nous. »
Tu n’es pas du genre à te bercer d’illusions, mais comment vois-tu l’avenir ?
« J’hésite entre deux postures. Quand je suis très déprimée, je me dis que ça va mal aller, cette nouvelle société qu’on va construire. J’ai peur que le capitalisme effréné reprenne, qu’on oublie les leçons de ce qui arrive, qu’on reprenne comme si de rien n’était en ayant des mesures plus paranoïaques. Et puis, par moments, je me dis, bien non, malgré les morts – il ne faut vraiment pas oublier qu’il y a des gens qui meurent – c’est une formidable occasion de changer le monde. Mais, tu le sais, je ne suis pas une grande optimiste. Je pense qu’on veut juste redémarrer la machine. Ne devrait-on pas écouter cette panne du système ? Mais je vois autour de moi beaucoup de jeunes qui, eux, croient que ça va changer les choses. Ils sont très blessés en ce moment, avec l’impression que ça fait des années qu’ils parlent d’écologie et qu’on ne les a pas écoutés et que maintenant ça pète. Je trouve ça pas mal qu’on prenne la mesure de notre vulnérabilité dans les pays industrialisés. Une vulnérabilité qui est liée à la condition humaine. Nous sommes des êtres fragiles. »