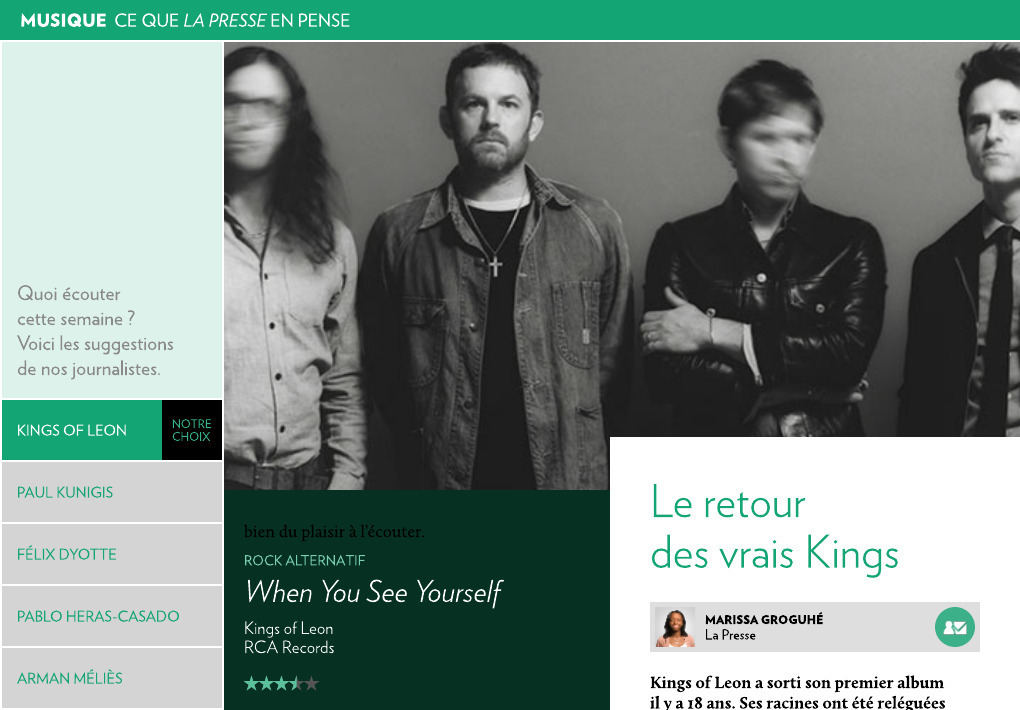Le retour des vrais Kings
Kings of Leon a sorti son premier album il y a 18 ans. Ses racines ont été reléguées au second plan lorsque le quatuor a mordu à l’appât du succès commercial. Il y revient toutefois avec When You See Yourself, un huitième opus plus authentique, qui bénéficie aussi des années d’expérience et de la maturité des Kings.
Pour ce huitième long-jeu, les musiciens de Nashville sont retournés à leurs racines, au rock de leurs débuts. On se trouve à des lieues d’Only by the Night (2008), qui nous avait donné les populaires Sex on Fire et Use Somedy. On est aussi bien loin de l’insipide WALLS (2016).
When You See Yourself est terminé depuis plus d’un an, alors même que la pandémie n’était qu’un constat historique plutôt qu’un cauchemar prêt à devenir réalité. La pièce-titre, qui ouvre l’album, comporte un appel à ralentir, à « rester ici, une dernière nuit ». Il est intéressant de l’écouter aujourd’hui, après la plus lente des années qui soit. Pour ce groupe qui un jour fut plus jeune et déjanté, on peut recevoir cet appel comme un constat qu’il est maintenant temps de se poser.
The Bandit, une épopée western comme Kings of Leon sait les raconter, est tout simplement exquise, dans son fond comme dans sa forme. L’excellente Golden Restless Age est un retour aux souvenirs de jeunesse, un constat du chemin traversé et de celui qui reste à parcourir. Caleb Followill, meneur et principal parolier, parle en entrevue d’une « acceptation ».
Sur Claire & Eddie, Jared Followill prend la plume pour faire une sorte de déclaration d’amour à la planète. « Le feu va faire rage si les gens ne changent pas », chante Caleb, sur des airs de ballade. Echoing prend un rythme effréné et Fairytale, juste après, calme brusquement la cadence. On apprécie ce relief, qui permet à la voix de Caleb Followill, une des meilleures constantes de l’offre de Kings of Leon, de briller d’une façon, puis d’une autre.
« On a relégué la radio et les ventes au second plan pour créer un album qu’on aime », a dit Jared Followill à Apple Music. Une sage et bénéfique décision. Les Kings ont eu du plaisir à créer cet album, et nous avons maintenant bien du plaisir à l’écouter.
Rock alternatif
When You See Yourself
Kings of Leon
RCA Records
3 étoiles et demie