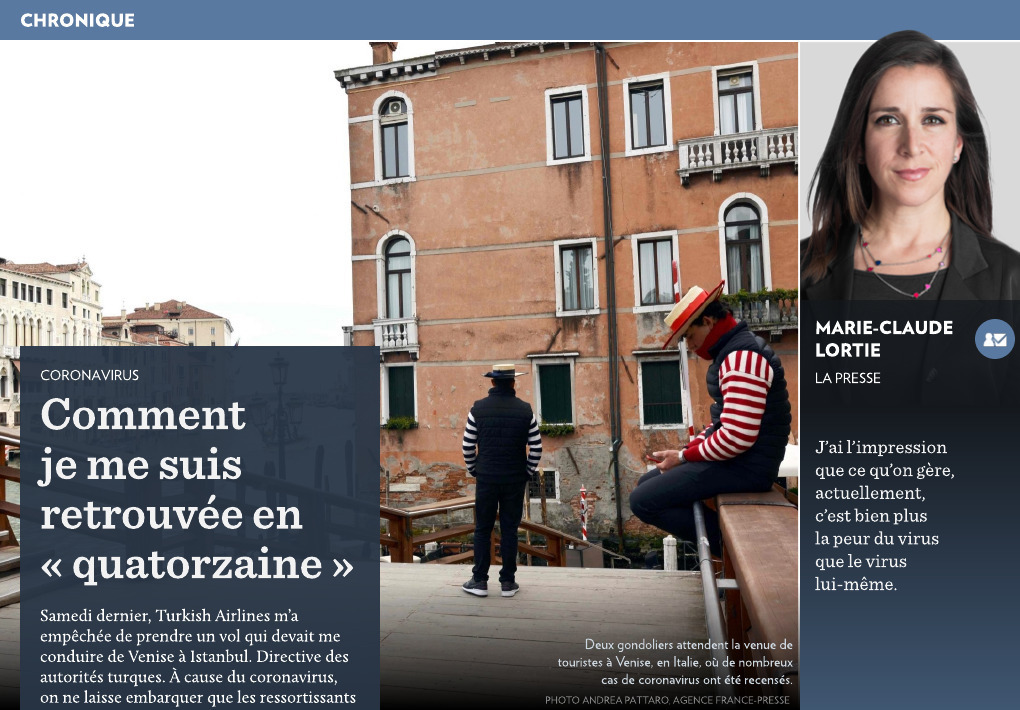Comment je me suis retrouvée en « quatorzaine »
Samedi dernier, Turkish Airlines m’a empêchée de prendre un vol qui devait me conduire de Venise à Istanbul. Directive des autorités turques. À cause du coronavirus, on ne laisse embarquer que les ressortissants de Turquie.
Mon reportage en Italie du Nord devra durer un jour de plus.
Le lendemain, après m’être rendue à Milan en train pour y constater la morosité totale causée par le virus, je prends un autre vol, qui m’amènera à Paris, puis à Istanbul. J’embarque sans difficulté.
On ne me demande nulle part si je suis même passée récemment par la Chine ou l’Iran. Pas de prise de température ni aucune des autres mesures pourtant déployées durant la semaine précédente, ici et là.
À Istanbul, ce qui préoccupe l’agent d’immigration à l’aéroport, c’est l’achat de mon visa.
Par contre, une fois en ville, les amies italiennes que je rencontre sont embêtées. Elles ont dû changer leurs billets d’avion pour rentrer à la maison en faisant escale dans une autre ville européenne. Les vols directs ne marchent plus.
Dans mon cas, pour mon retour à Montréal quelques jours plus tard, tout baigne. Je passe par Paris.
Et là encore, sur mon chemin, personne, personne ne me demande si je suis allée récemment en Chine, en Iran ou en Italie du Nord. Ce qui préoccupe l’agente des services frontaliers à mon arrivée au Canada, c’est si je rapporte du fromage ou du saucisson, en plus de mes pistaches et de ma confiture. « Vraiment ? Êtes-vous bien sûre ? »
En attendant l’Uber qui me ramènera à la maison, je parle avec la direction du journal. Et si tu faisais une « quatorzaine » ?
C’est probablement plus sage.
Donc je vous écris de la maison. Et je lis sur le sujet. Il est préférable de ne pas cuisiner pour la famille. De ne pas être celle qui fait le ménage. De ne surtout pas faire la vaisselle.
Zut !
Appel à une amie médecin. « Je ne pourrais pas me faire tester tout de suite, qu’on en ait le cœur net ?
— Non, on fait juste les tests pour confirmer le diagnostic, si tu as les symptômes. »
Or, pour le moment, je n’en ai aucun.
Je lis un peu plus sur le sujet. Les symptômes peuvent mettre jusqu’à 14 jours à apparaître, mais ça arrive dans la vaste majorité des cas de cinq à sept jours après la contamination.
Donc, à partir de dimanche, le risque va diminuer puisque j’ai quitté Milan dimanche dernier.
Mais en réalité, le risque est déjà minime. Je n’ai pas été longtemps en Italie. Je ne me suis pas approchée des hôpitaux. Je ne suis pas allée dans des spectacles, des réunions, des rassemblements. Je me suis lavé les mains mille fois.
Je n’ai vraiment pas peur d’avoir contracté le coronavirus.
***
Je vous raconte tout ça pour dire qu’après deux semaines de voyage, y compris dans des zones à risque, j’ai l’impression que ce qu’on gère, actuellement, c’est bien plus la peur du virus que le virus lui-même.
Les vols annulés ici et là, la prise de température un jour et pas l’autre…
Je ne dis pas que personne ne fait rien d’utile.
Je dis qu’il faut réagir en adulte. Or, puisque la population semble avoir perdu ou n’avoir jamais eu, collectivement, la capacité de gérer le risque de façon adulte, les autorités en tous genres prennent ici et là des initiatives qui donnent surtout l’impression qu’on agit. Mais qui sont souvent totalement inutiles.
Une proche vient de voir un voyage précieux et prévu depuis longtemps annulé, parce que c’était en Italie, pourtant dans une partie du pays qui n’est pas plus visée par le problème que le reste de l’Europe.
De toute évidence, on gère ici la peur. Pas la réalité. Un voyage à New York, au Mexique, aurait-il aussi été annulé ?
Les masques que tant de gens portent : ils ne protègent pas du virus, à part certains modèles, pour une période très courte. Ce qu’ils font, les masques, c’est limiter ce qu’on peut projeter dans l’air en toussant. Pourtant, demandez à ceux qui les ont sur la bouche et le nez : ils pensent, pour la plupart, que c’est une mesure pour ne pas attraper le virus. Non, c’est pour ne pas le donner… Mais ça aide à gérer la peur.
Je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais bravo à Doug Ford, le premier ministre ontarien, qui vient d’annoncer que le traitement des problèmes d’anxiété sera maintenant couvert par l’assurance maladie de la province.
C’est de ça qu’on a besoin actuellement, autant que d’un vaccin ou d’un test de dépistage du virus.
On a besoin d’aide pour que l’anxiété face à la contamination ne nous empêche pas de vivre normalement. Et de prendre des décisions rationnelles.
Parce que la réalité, c’est que dès qu’on sort de chez soi, on commence à être à risque.
La vie au complet est un vaste exercice de gestion du risque.
Le virus fait maintenant partie de l’équation.
Comme le sida, les accidents de voiture, les écrasements d’avion, la foudre.
***
Je vais rester chez moi le temps prévu, à ne pas faire la vaisselle et à ne pas cuisiner. Je le fais parce que c’est la façon responsable d’agir face à mes concitoyens, mes collègues. La probabilité que j’aie attrapé quoi que ce soit est infiniment petite. Mais je ne peux pas imposer cette analyse aux autres.
Sauf que sérieusement, en Italie, si j’ai mis ma vie en danger, c’est bien plus en conduisant sur les petites routes du Frioul, de Vénétie et de Lombardie, où des camions immenses frôlaient ma voiture à des vitesses folles.
Je vous le dis, ça, ça m’a fait vraiment peur.
Mais vous savez quoi ? Je suis OK. Et je ne vais pas arrêter de prendre le volant.