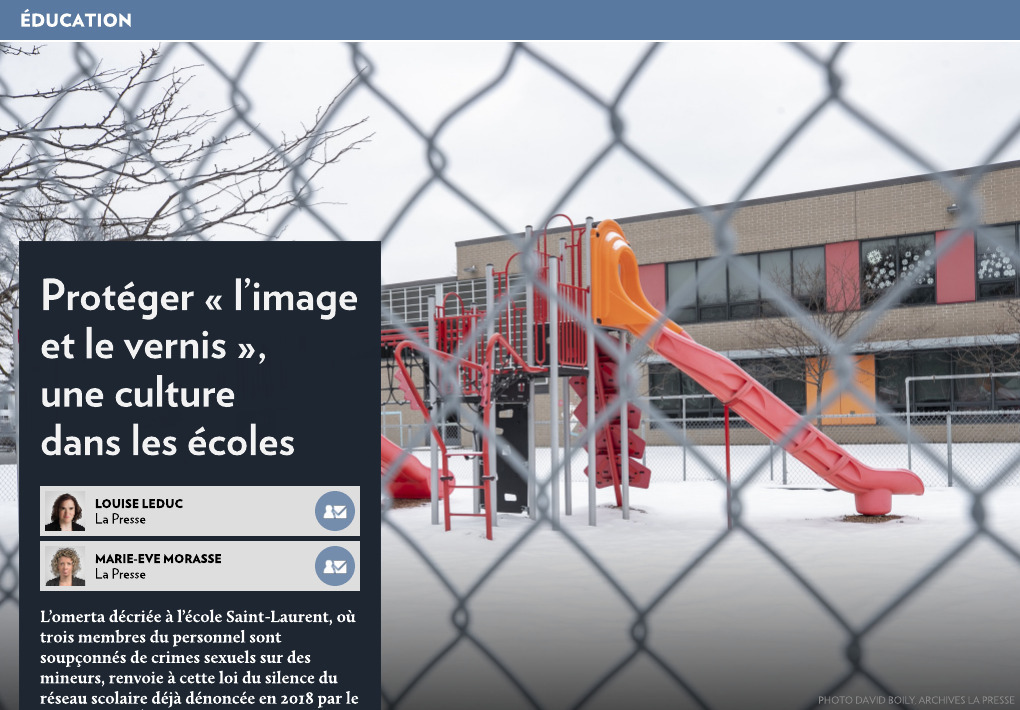Protéger « l’image et le vernis », une culture dans les écoles
L’omerta décriée à l’école Saint-Laurent, où trois membres du personnel sont soupçonnés de crimes sexuels sur des mineurs, renvoie à cette loi du silence du réseau scolaire déjà dénoncée en 2018 par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. La question demeure entière : le personnel des écoles peut-il dénoncer les failles du système sans risquer des représailles ?
L’enseignante Kathya Dufault a payé cher sa prise de parole en 2018. Après avoir dénoncé les conditions de travail qu’elle jugeait inacceptables à son école secondaire, elle a fait face à une procédure de congédiement. La commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) lui a reproché de l’avoir « critiquée publiquement ».
Quatre ans plus tard, le cas de l’école Saint-Laurent lui fait dire : « L’omerta est encore là. Ça me fâche. »
Dans les écoles, poursuit Mme Dufault, « tout doit toujours avoir l’air parfait ». « Les profs doivent embarquer là-dedans s’ils veulent garder leur job. »
Elle évoque les notes gonflées, les profs qu’on fait taire, les diplômes au rabais, les « beaux tableaux » qui ne reflètent pas la réalité du terrain.
Dans la foulée de sa sortie publique, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, avait promis une clause dans les conventions collectives visant à libérer la parole des enseignants qui auraient besoin de « dénoncer les travers » du système.
À deux reprises, M. Roberge a tenté de mettre en place un tel mécanisme, jugé finalement inopportun, une telle protection étant déjà offerte par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles.
Un professeur peut dénoncer une situation qu’il juge inacceptable « sans peur de représailles, de façon anonyme, auprès du Protecteur du citoyen », souligne à La Presse Florent Tanlet, attaché de presse du ministre Roberge.
Mais monter ainsi au créneau suppose de monter un dossier, « un effort » que les profs, déjà sur le mode survie, ne peuvent pas toujours fournir, dit Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal (représentant les enseignants du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys).
« Avec l’énergie du désespoir », certains le font – souvent en interpellant les médias, précise Mme Hubert – quand les situations deviennent intenables.
Les « représailles plus invisibles »
Mélanie Hubert le dit franchement. « On cherche à préserver l’image et le vernis du centre de services scolaire, de l’école, parfois de la direction. »
« Les apparences, l’image, le rayonnement » pèsent lourd dans la balance.
« Dans beaucoup de situations, on ne veut pas faire venir la police, déclencher des enquêtes ou réagir parce que ça va mal nous faire paraître. On essaie de régler les choses autrement, de les couvrir. »
— Mélanie Hubert, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal
Au-delà des processus d’enquête, des suspensions et des mesures disciplinaires, les profs ont peur des « représailles plus invisibles » : « peur d’une direction qui va chercher un peu à nous faire payer le prix de ce qu’on a dit en nous donnant les groupes les plus difficiles, en nous donnant les locaux ou les horaires les moins intéressants, en faisant obstruction quand on a besoin d’aide pour avoir des services », énumère Mme Hubert.
À l’école Saint-Laurent, une employée souligne à La Presse que l’un des hommes arrêtés était gestionnaire et qu’il avait le pouvoir d’empoisonner le quotidien du personnel. Malgré cela, ces derniers jours, des employés ont assuré avoir tenté en vain de sonner l’alarme devant certains faits qu’ils jugeaient troublants.
Comme l’ont fait aussi, dans une tout autre affaire, une vingtaine d’enseignantes, elles aussi du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB). Il aura fallu plus d’une décennie de plaintes contre un concierge qui les harcelait et leur faisait des attouchements pour qu’il soit finalement congédié l’automne dernier, non sans avoir d’abord travaillé dans cinq écoles au gré de mutations.
Une loyauté due à l’élève, pas aux gestionnaires
Selon Pierre Trudel, professeur au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, c’est toute la culture des centres de services scolaires, trop souvent autoritaires et opaques, qui doit être changée.
Le personnel scolaire, ajoute-t-il, place sa loyauté au mauvais endroit. « La loyauté n’est pas due aux gestionnaires, mais à l’institution. Donc à l’élève. »
Les parents qui, eux, veulent porter plainte sont dirigés vers le Protecteur de l’élève de leur centre de services scolaire. En 2017, dans un rapport spécial sur la question, le Protecteur du citoyen mettait cependant en lumière les nombreuses lacunes de ces instances, dont de trop longs délais, leur manque d’indépendance, leur faible reddition de comptes, etc.
Québec a donc choisi de créer un Protecteur national de l’élève. Si des acteurs du monde de l’éducation fondent de grands espoirs sur cette nouvelle mouture, Pierre Trudel doute qu’elle soit la solution.
« Il aura un local dans l’édifice Marie-Guyart [où travaillent les fonctionnaires du ministère de l’Éducation] et de son bureau à Québec, il va recevoir des courriels de gens qui vivent des problèmes à Gatineau, à Drummondville… Ça fera un bureau de plus qui sera occupé, mais je ne vois pas trop ce que ça peut changer », à moins, espère-t-il, qu’il ait de réels moyens d’enquête.
Pour tout dire, Pierre Trudel estime que les parents, les élèves et le personnel scolaire lésés n’ont finalement que trois options : la police, les médias, la Commission des droits de la personne.
« Et qu’ont en commun ces trois-là ? demande-t-il. C’est d’être totalement indépendants du réseau scolaire », relève-t-il.
La peur des représailles, même chez les parents
Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), estime que la peur de représailles, « mais aussi, la peur de nuire au climat de l’école », explique notamment cette réticence du personnel à y aller de dénonciations, chose jamais facile quand c’est un gestionnaire ou un collègue qu’on côtoie sur une base régulière.
« Cette peur de représailles est aussi celle de parents, qui ont eux-mêmes peur d’effets collatéraux néfastes pour leurs enfants. »
Faut-il d’autres lois, d’autres instances, d’autres programmes ? M. Prévost est convaincu qu’« on a déjà en main tout ce qu’il faut », notamment la Loi sur l’instruction publique qui garantit le droit à une éducation gratuite, dans un climat sain et sûr.
Il rappelle aussi que le réseau scolaire bénéficie d’un plan très établi (et assorti d’un financement de plusieurs millions de dollars) pour prévenir et contrer « toute forme d’intimidation à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’école ».
Des demandes souvent refusées et ignorées
Les arrestations à l’école Saint-Laurent ternissent l’image que le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys s’est construite en diffusant notamment des communiqués dans lesquels il se félicite par exemple de figurer parmi les meilleurs employeurs au pays, d’avoir un « statut de leader en diplomation » ou d’avoir bien fait au Grand Défi Pierre-Lavoie. Mais les demandes formulées sur divers sujets au cours des derniers mois par La Presse au service des communications du CSSMB ont été ignorées à maintes reprises. Au centre de services scolaire de Montréal, le plus grand du Québec, La Presse en est à sa troisième demande d’entrevue avec Jean-François Lachance, qui a été nommé en juin par le gouvernement Legault pour gérer la tutelle mise en place par Québec. Début octobre, le centre de services nous a dit qu’il était en vacances. À son retour fin octobre, notre nouvelle demande est restée sans réponse. Il y a quelques jours, le centre de services scolaire nous a dit qu’il faudrait attendre après la relâche, à l’entrée en poste de la nouvelle directrice générale.