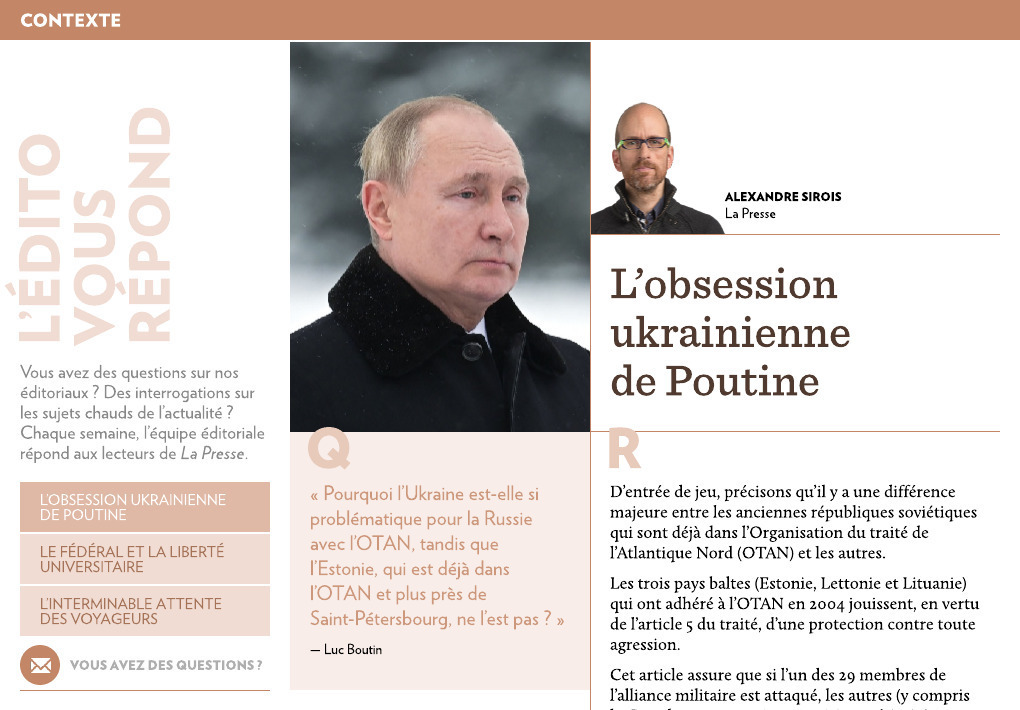L’obsession ukrainienne de Poutine
D’entrée de jeu, précisons qu’il y a une différence majeure entre les anciennes républiques soviétiques qui sont déjà dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les autres.
Les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) qui ont adhéré à l’OTAN en 2004 jouissent, en vertu de l’article 5 du traité, d’une protection contre toute agression.
Cet article assure que si l’un des 29 membres de l’alliance militaire est attaqué, les autres (y compris le Canada et notre puissant voisin américain) vont tous se porter à sa défense.
Tous pour un et un pour tous, en quelque sorte.
En 2014, Barack Obama avait déclaré publiquement que les trois capitales des pays baltes, Tallinn, Riga et Vilnius, étaient aussi importantes « à protéger que Berlin, Paris et Londres ».
La protection offerte par l’article 5 est assurément à même de refroidir les ambitions du président russe Vladimir Poutine…
Cela dit, pour répondre à votre question, il est important de préciser que la Russie n’a pas non plus aimé voir les trois pays baltes se joindre à l’OTAN.
Mais à l’époque, « la Russie n’avait tout simplement pas les moyens de s’opposer à cette adhésion », rappelle Ekaterina Piskunova, qui enseigne au département de sciences politiques de l’Université de Montréal et se spécialise en politique étrangère russe et relations russo-américaines.
L’écart entre la puissance russe du début des années 2000 et celle d’aujourd’hui fait donc partie de l’équation.
Mais le portrait ne serait pas complet si on s’arrêtait là.
Le monde d’aujourd’hui est dominé par les questions identitaires, et cette région du globe n’échappe pas à cette tendance lourde.
« Du point de vue russe, tel qu’il est projeté par le régime et largement soutenu par la population, non seulement l’Ukraine a une histoire commune avec la Russie, mais les Ukrainiens et les Russes forment aussi un seul peuple », explique Dominique Arel, titulaire de la Chaire en études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa.
Vladimir Poutine a même publié un long texte à ce sujet l’été dernier sur son site web, rappelle l’expert.
Ce qui ne signifie toutefois pas que la majorité de la population ukrainienne partage l’avis du président russe, cela dit.
Ce qui est indiscutable, en revanche, c’est que l’histoire de la Russie et celle de l’Ukraine sont liées. La Russie kiévienne, entre le IXe et le XIIIe siècle, était un territoire qui engloberait aujourd’hui des pans des deux pays.
Il y a donc une communauté historique partagée, mais aussi « une communauté linguistique, une communauté religieuse, une communauté économique et une communauté familiale », souligne Ekaterina Piskunova.
En ce sens, la situation de l’Estonie est également bien différente de celle de l’Ukraine.
« Même s’il y a une certaine histoire commune entre la Russie et les républiques baltes, ce n’est pas la même chose sur le plan identitaire, car la culture dominante était allemande. Il y a un passé commun historique qui n’est pas identitaire », précise Dominique Arel.
Sans compter l’explication purement géopolitique.
« On parle de l’importance de la frontière avec l’Ukraine, de la longueur de cette frontière et de la difficulté de la protéger », ajoute Ekaterina Piskunova, qui estime aussi que le changement de politique étrangère de la part de Moscou est utile pour comprendre ce qui se passe actuellement.
La Russie est plus que jamais à couteaux tirés avec l’Occident et tout éventuel élargissement de l’OTAN est vu par Vladimir Poutine comme un affront et une menace.
Il nous reste à espérer, malgré l’escalade, que la diplomatie triomphera et qu’on évitera un conflit armé d’envergure.