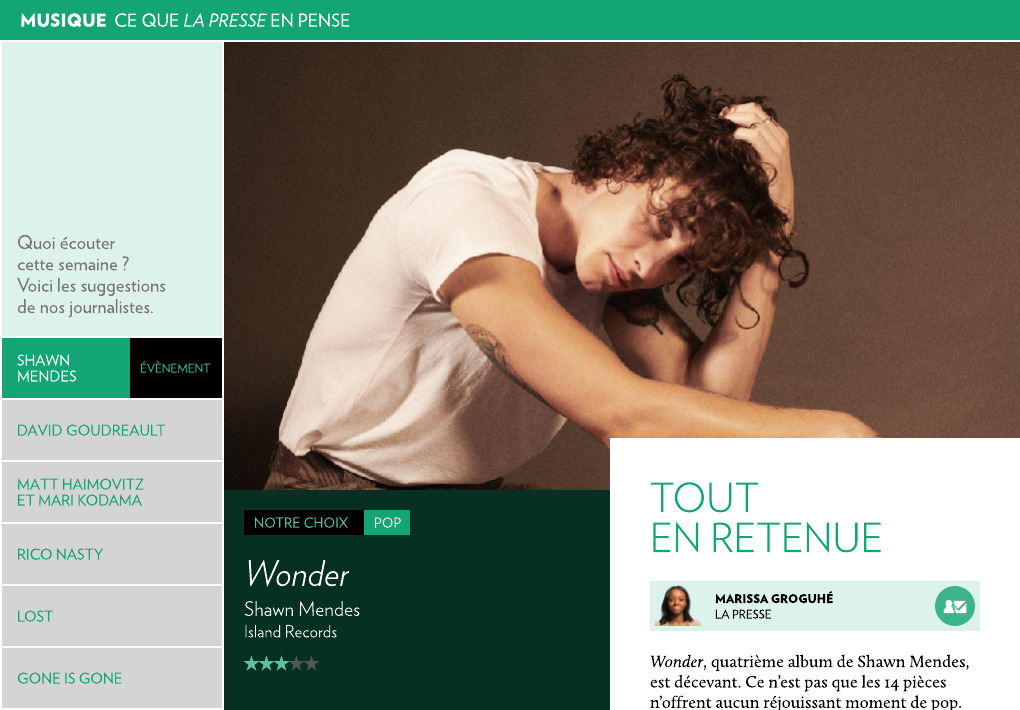tout en retenue
Wonder
Shawn Mendes
Island Records
Trois étoiles
Wonder, quatrième album de Shawn Mendes, est décevant. Ce n’est pas que les 14 pièces n’offrent aucun réjouissant moment de pop. Certains morceaux sont très bien, même. C’est plutôt qu’on sent tout au long un potentiel bien plus grand, que l’artiste se retient d’explorer.
Shawn Mendes ne présente publiquement qu’une image très aseptisée et polie de lui-même. Il semble parfait, fait très attention à ce qu’il fait et à comment il le fait. Musicalement, c’est la même chose. Il l’avoue, il est perfectionniste, très dur envers lui-même et anxieux de voir son succès lui glisser entre les mains. Cela semble avoir pour conséquence directe de paralyser sa créativité. Son offre est immensément prudente. Ç’a toujours été le cas, mais lorsque ce quatrième opus a été annoncé, on aurait pu espérer y trouver un Shawn Mendes plus certain, prêt à assumer des prises de risques. Mais non.
Mendes n’a que 22 ans. Wonder est son quatrième album, mais il grandit encore, prudemment, à la recherche de ce qui le distinguera. Ou peut-être se complaît-il exactement là où il se trouve ? Si c’est le cas, il continuera de très bien faire commercialement, sans jamais exceller dans son art. Pourtant, le potentiel est là.
La pop insufflée de rock du Canadien est convenue, mais elle est très bien chantée. Vocalement, Shawn Mendes fait extrêmement bien, il atteint des octaves qu’il ne pouvait tenter auparavant.
Surtout, la réalisation de cet album est salvatrice. Si les textes n’ont pas grand-chose de percutant et si les mélodies des couplets sont trop souvent banales, la présence instrumentale des refrains redonne vie à plusieurs pièces. Par exemple, sur Always Been You ou Call My Friends, où la performance des musiciens fait tout le travail.
Une chanson plutôt fade comme Dream devient tout à coup intéressante lorsque l’on s’attarde au travail de composition instrumentale et à la limpidité de la production. L’introduction de l’album, d’une minute seulement, a été composée à huit mains. Ça fait beaucoup de monde pour six phrases, mais l’instrumentation, encore une fois, est tout à fait exquise. Le refrain de Wonder et son interlude, où les chœurs et la batterie, grandioses, guident l’allure, auront un bel impact en concert.
Un grand merci est dû à Frank Dukes (Drake, Camila Cabello), Kid Harpoon (Harry Styles), Scott Harris (The Chainsmokers) et Nate Mercereau (Lizzo), qui sont de toutes les compositions, écrites ou coécrites par Mendes.
Le R&B sur Monster, en duo avec Justin Bieber, est bienvenu. Les deux musiciens, dont les parcours ont quelques similarités (des Canadiens devenus célèbres très jeunes), abordent les différents désagréments de la vie qu’ils ont choisie, où tous leurs gestes sont scrutés, où le piédestal sur lequel on les a mis peut donner le vertige. Mendes s’ouvre sur le sujet plus d’une fois, notamment avec Call my Friends, où il chante son désir de « prendre des vacances de sa vie » pour voir ses amis et vivre quelques instants de normalité.
Sans surprise, la plupart des titres de l’album sont toutefois des chansons d’amour. Dans le documentaire In Wonder, paru sur Netflix à la fin du mois de novembre, qui suit Shawn Mendes durant la fin de sa tournée et dans la création de ce nouvel album, il raconte à la caméra que tous les textes qu’il a écrits par le passé portent sur son amour pour la chanteuse Camila Cabello. Wonder est une suite logique. La pièce 305 porte le nom de son indicatif régional, Dream raconte que le jeune homme rêve à elle lorsqu’elle n’est pas à ses côtés, Can’t Imagine parle du fait qu’il ne peut envisager sa vie sans elle, etc.
Malgré tout, Shawn Mendes reste en surface. Il chante ce qu’il sent que le public veut entendre, de la façon dont il veut l’entendre. Il ne se trompe pas dans la façon de faire, Wonder est plaisant, la radio se délecte déjà des extraits parus ces derniers temps. Mais le problème, lorsqu’un artiste fait ce qui « doit » être fait pour plaire, c’est que sa personnalité s’en retrouve diluée. On espère bientôt découvrir Shawn Mendes sans barrières ni artifices.