Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 5 mars 2023,
section CONTEXTE, écran 2


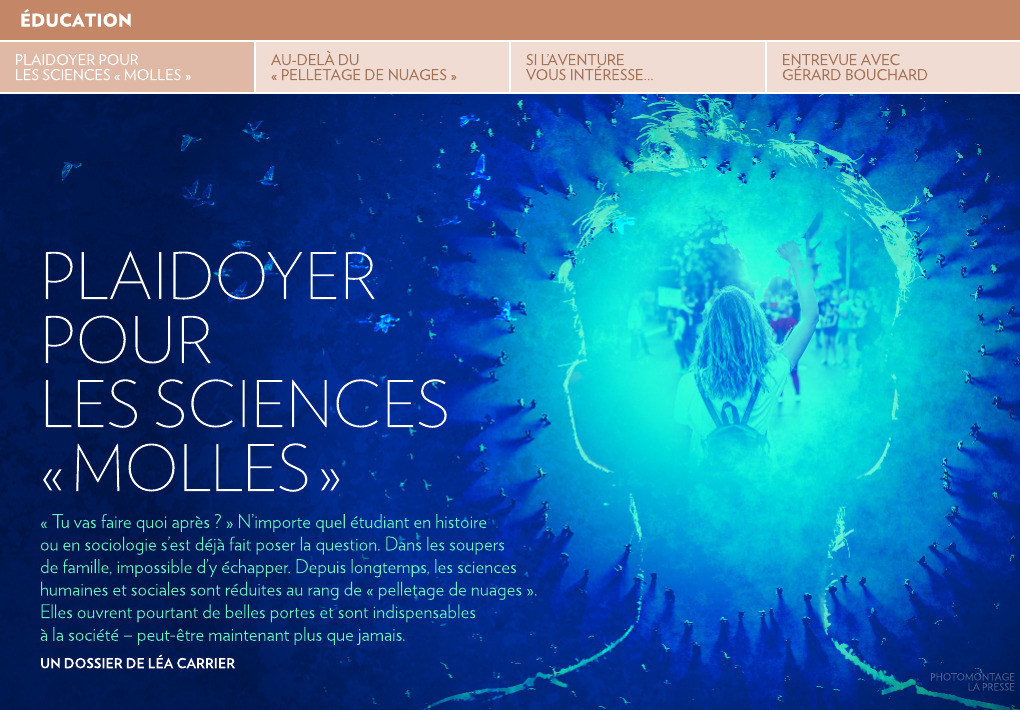
« T’étudies en quoi ?
— En sociologie.
— OK, pis… Tu vas faire quoi avec ça ? »
Anaël Bisson connaît le scénario par cœur. Comme la plupart des étudiants en sciences humaines et sociales, elle l’a joué des dizaines et des dizaines de fois.
Non, la sociologie n’est pas du « pelletage de nuages », assure-t-elle. Étudier les inégalités sociales, les structures d’une société, c’est essentiel. Et c’est ce qui l’anime.
Pourtant, la question revient continuellement. Lors de nouvelles rencontres, impossible d’y échapper.
« “Tu vas faire quoi après ?” Même quand j’explique mon choix, c’est comme si ce n’était pas assez. »
— Anaël Bisson, étudiante en sociologie à l’Université de Montréal
La critique ne date pas d’hier, mais elle est toujours aussi vraie : les sciences humaines et sociales sont souvent discréditées, voire ridiculisées.
Les plombiers et les électriciens gagnent « très bien leur vie », a récemment déclaré le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, lors d’une annonce sur un investissement de 81,3 millions dans la formation professionnelle d’ici 2027. « Je suis un diplômé de science politique, je suis capable de comparer… », a-t-il blagué, provoquant des rires dans l’auditoire.
Ça n’a pas toujours été le cas. Il fut une époque où les intellectuels issus des sciences humaines étaient hautement valorisés et où leur expertise pour orienter les grands choix de société était célébrée.
« Il y a un discrédit qui commence à peser sur les sciences humaines et sociales », se désole le sociologue et historien Gérard Bouchard.
Et il faut s’en alarmer, croit-il.
La catastrophe climatique nous guette, la démocratie recule à l’échelle internationale pendant qu’une guerre fait rage à l’autre bout du monde.
Pas de doute, les défis devant nous sont colossaux. Et les diplômés en sciences humaines et sociales pourraient apporter une partie de la solution.
Mieux financer la recherche
« Plus que jamais, les sciences humaines et sociales sont indispensables », martèle le président de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Jean-Pierre Perreault.
L’humanité fait face à de grands problèmes sociaux que la technologie seule ne pourra résoudre sans l’apport des ethnologues, des philosophes, des géographes…
À condition de valoriser celui-ci.
« Et là, il y a peut-être un défi. Il faut sortir de cette vieille histoire qu’on les met de côté, qu’ils sont moins importants. Non, non, non. Ils ont une place prépondérante dans notre société », fait valoir M. Perreault.
Les champs de recherche couverts par les sciences humaines et sociales varient selon le pays et l’époque, mais de manière générale, ils incluent tant la psychologie, l’économie, le droit et la philosophie que la géographie, l’histoire, les arts et la littérature, entre autres.
Ces disciplines représentent plus de la moitié des étudiants, tous cycles confondus, au Québec.
Selon des données obtenues par La Presse, les universités québécoises ont reçu en financement de la recherche un peu plus de 1,52 milliard des administrations publiques fédérale et provinciale en 2020-2021. Sur cette somme, les fonds de l’ensemble du secteur des sciences humaines et sociales représentent seulement 24,2 %, soit environ 368 millions de dollars.
Les sciences humaines et sociales souffrent d’un sous-financement « important », croit Stéphane Paquin, professeur titulaire et directeur du doctorat et de la formation à la recherche à l’École nationale d'administration publique (ÉNAP).
Il le voit, entre autres, dans les ratios profs-étudiants élevés et dans les administrations qui mettent fin à des cours parce que les inscriptions sont trop peu nombreuses. Aussi, sur 65 étudiants inscrits au doctorat à l'ÉNAP, à peine six sont boursiers du Conseil de recherches en sciences humaines ou du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, les deux principaux organismes subventionnaires en sciences humaines au pays. « C’est microscopique ! », dénonce-t-il.
À l’Université du Québec de Montréal (UQAM), la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Josée S. Lafond, déplore aussi « des disparités » dans le financement de ces disciplines. « Oui, on les respecte de plus en plus, mais il n’en reste pas moins que lorsqu’elles sont en compétition avec les sciences médicales, par exemple – ce qu’elles ne devraient jamais être –, on voit des disparités », remarque-t-elle.
Certes, construire un laboratoire de recherche ou former un étudiant en génie aérospatial coûte cher. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, reconnaît toutefois qu’il manque de bourses pour le nombre d’étudiants en sciences humaines et sociales. « C’est certain qu’on n’est pas capable d’offrir des bourses d’excellence à plusieurs d’entre eux, peut-être parce que les moyens ne sont pas là », dit-il.
Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé une importante réduction des fonds alloués aux programmes artistiques dans les universités en 2021, soit la musique, la danse, le théâtre et les études médiatiques.
La réforme, qui a suscité une vive opposition, vise à injecter davantage d’argent dans les secteurs dits « prioritaires », notamment la santé, la technologie et le génie.
Au début du mois, en Grèce, des étudiants et des professionnels du monde culturel sont descendus dans les rues pour dénoncer un décret du gouvernement qui, selon eux, dévalue les études en arts et dévalorise leurs diplômes, avec des conséquences sur leurs salaires, leurs protections sociales et leurs retraites.
Au Québec, Rémi Quirion et Jean-Pierre Perreault s’entendent qu’il faut davantage soutenir la recherche scientifique, et ce, dans tous les secteurs.
Surtout, il est urgent de changer le discours autour des sciences humaines et sociales.
« Il faut dire haut et fort que le développement des sciences humaines et sociales est essentiel pour la société. Et j’invite les jeunes à s’y intéresser. »
— Jean-Pierre Perreault, président de l’Acfas
L’option par défaut
Encore faut-il qu’elles soient attrayantes pour un jeune qui sort du secondaire. Qui n’a pas déjà entendu que les sciences humaines et sociales n’ont pas de débouchés ? Qu’elles ne servent à rien ?
« Ne te ferme pas des portes ! », recommande-t-on à nos ados au moment de choisir un programme collégial. « Tu as de bonnes notes. Pourquoi veux-tu aller en sciences molles ? », leur demande-t-on sur un ton plein de bienveillance.
À l’université aussi, les clichés ont la vie dure. Les départements de philo ou de littérature hériteraient des locaux vétustes et leurs étudiants vivraient aux crochets de leurs parents.
Ces préjugés, la professeure de sociologie au cégep de Limoilou, Isabelle Morin, les entend régulièrement.
Pour les parents, les sciences de la nature (ou « sciences fortes ») sont un choix « sécurisant ».
« Ils se disent que leur enfant va s’ouvrir toutes les portes. Mais les sciences humaines ouvrent autant de portes ! C’est juste pas les mêmes. »
— Isabelle Morin, professeure de sociologie au cégep de Limoilou
Des exemples ? Avec un diplôme d’études collégiales en sciences humaines, un jeune peut poursuivre des études en psychologie, en droit, en urbanisme, en économie ou même en criminologie.
Plus jeune, Anaël Bisson rêvait de devenir médecin. Douée à l’école, ses mauvaises notes en maths ont toutefois freiné son ambition, et la jeune femme s’est retrouvée dans un programme de sciences humaines au cégep.
« Je pensais que les sciences humaines étaient plus faciles, que c’était pour ceux qui n’étaient pas capables de faire des maths », se souvient-elle.
L’option par défaut, quoi.
Même qu’elle a conservé ses appréhensions longtemps, en s’inscrivant d’abord en relations internationales à l’université.
« Au début, je n’étais pas capable de m’inscrire juste en sociologie, parce que j’avais peur d’être mal payée ou d’avoir moins de perspectives de carrière. »
— Anaël Bisson, étudiante
La recherche l’intéresse, peut-être l’enseignement, et encore… « Même avec les enseignants, on fait des jokes entre nous qu’on n’est pas ici pour être payés cher », raconte-t-elle.
Trop abstraites, souvent rébarbatives : la nécessité des sciences humaines et sociales n’est pas toujours bien comprise des jeunes, croit Isabelle Morin. Et c’est notre rôle à tous, parents et profs, de leur faire comprendre.
« Je dis souvent à mes étudiants : “Soyez fiers de vous intéresser aux sciences humaines. L’être humain est infiniment complexe, alors imaginez une gang d’êtres humains ensemble. Ça prend des têtes bien faites pour essayer de comprendre cette gang-là” », dit Mme Morin, qui est aussi coordinatrice du programme de sciences humaines de son cégep.
« Il faut leur montrer que ce n’est pas du pelletage de nuages, que c’est concret, tangible », souligne-t-elle.
Où sont les intellectuels ?
Évidemment, il y a encore des intellectuels, diplômés en sciences humaines et sociales, dans les médias qui nous éclairent sur les grandes questions de société et qui résistent aux débats courts et précipités dont semblent désormais faites la plupart des émissions d’affaires publiques.
Mais pas autant qu’avant ni en aussi grand nombre qu’il le faudrait, croit Jean-Philippe Pleau.
Le sociologue de formation a longtemps coanimé l’émission C’est fou… avec l’anthropologue Serge Bouchard, mort en 2021.
« La représentation médiatique qu’on a des sociologues, des anthropologues, des philosophes s’est transformée. »
— Jean-Philippe Pleau, sociologue et animateur
« J’ai tout le temps les mains dans les archives. Dans les années 1980-1990, il y avait beaucoup de place pour les sociologues. Ils étaient invités sur plein de tribunes. Pas juste pour des clips de sept secondes, mais pour commenter un fait d’actualité avec une perspective sociologique », poursuit-il.
L’émission Chasseur d’idées, animée par le journaliste Michel Désautels à la fin des années 1990, en est un bon exemple. « C’était des longues réflexions. Il n’y avait pas de vedettes, pas de débat. »
La même émission pourrait-elle exister aujourd’hui ? « Je ne pense pas qu’il y a des diffuseurs qui oseraient », répond l’animateur.
Pourtant, il existe une soif pour ce genre de contenu, et la popularité de Serge Bouchard en est peut-être l’une des démonstrations les plus probantes. La disparition du grand sage a laissé un vide non seulement dans l’espace médiatique, mais aussi dans le cœur des Québécois.
Qu’attendons-nous pour le combler ?
« Des Serge Bouchard, il y en a plein, mais ils n’ont pas de tribune. Je pense que c’est à nous de les chercher et leur donner une place », conclut Jean-Philippe Pleau.
— Avec la collaboration de Francis Vailles, La Presse
Anthropologie
Une société minière prévoit un projet situé tout près d’une communauté autochtone ? Il y a de fortes chances qu’elle fasse appel à l’expertise d’un anthropologue pour établir un dialogue avec elle. Première cheffe équité diversité et inclusion chez Hydro-Québec, Manuelle Alix-Surprenant est titulaire d’une maîtrise en anthropologie, souligne le site de l’Université de Montréal. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a elle aussi fait des études dans cette discipline. Employeurs fréquents : firmes de consultants, organismes publics, gouvernements, municipalités.
Sociologie
Surprise ! Les diplômés en sociologie ont un excellent taux de placement, a démontré une récente enquête du ministère de l’Enseignement supérieur. Maisons de sondage, ministères, organismes communautaires : bien des employeurs recherchent leur expertise des comportements sociaux. Sur son site, l’Université Laval met de l’avant le parcours de Nathalie Gagnon, doctorante en sociologie qui travaille à titre de conseillère principale, stratégie et innovation en communications d’entreprise chez Desjardins. Une formation qu’elle qualifie d’enrichissante « pour moi, pour ceux que je côtoie, pour ma compréhension du monde », témoigne-t-elle.
Science politique
Ils travaillent souvent dans les coulisses du pouvoir comme stratèges politiques ou chargés de communication. Le journalisme est aussi une avenue populaire, comme le démontre Jean-François Lépine, journaliste et analyste réputé, qui est titulaire d’une maîtrise en science politique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ceux qui aiment le travail de terrain peuvent aussi s’épanouir après leurs études. Diplômée en science politique et en études internationales, Anne-Josée Boutin a réalisé plusieurs missions en République démocratique du Congo, en Birmanie et en Haïti avec Médecins sans frontières, indique le site de l’Université de Montréal.
Histoire de l’art
Les diplômés en histoire de l’art peuvent travailler dans divers milieux, dont les musées, les galeries d’art, les centres de documentation ou la fonction publique. Doctorante en histoire de l’art à l’UQAM, Valérie Rousseau travaille comme conservatrice au American Folk Art Museum, à New York, et veille à l’acquisition, à la conservation et à la présentation des collections, nous apprend le site de l’université.
Pour plusieurs, l’élection présidentielle de Donald Trump a été comme « un coup de tonnerre dans un ciel bleu ». « Qui l’avait prévue ? », lance l’historien et sociologue Gérard Bouchard.
En entrevue, l’intellectuel ne cache pas son inquiétude.
Le monde traverse une période de turbulences extrêmes, et pourtant, nous ne semblons pas préparés à y faire face.
En 2016, l’élection de Donald Trump a pris le monde par surprise, rappelle Gérard Bouchard.
« Après coup, on s’est rendu compte qu’il se passait quelque chose de grave dans la société américaine », observe-t-il.
L’arrivée au pouvoir de Donald Trump a révélé l’ampleur du clivage qui divise la société américaine. Les valeurs, les croyances communes qui la soutenaient autrefois sont en train de s’éroder.
Comment ressouder le lien social ? Comment préserver « un système de valeurs qui transcende les divisions » ? Ces questions ne sont pas banales, argue M. Bouchard. Elles sont même absolument fondamentales.
« Mais je ne vois pas d’efforts massifs, concentrés pour travailler sur ces grands problèmes. »
— Gérard Bouchard, historien et sociologue
Il y a un an, Gérard Bouchard signait une lettre dans Le Devoir dans laquelle il plaidait pour une « réforme de l’imaginaire scientifique ». Le savant, y écrivait-il, ne manipule pas uniquement les éprouvettes.
Au contraire, il faut « revaloriser » les spécialistes des sciences humaines et sociales qui réfléchissent notre monde. « Je pense que cela devrait faire partie des priorités d’un gouvernement », souligne M. Bouchard.
***
Âgé de 79 ans, Gérard Bouchard a connu l’« âge d’or des sciences humaines ».
« Je suis né scientifiquement à une époque où les sciences humaines étaient extraordinairement valorisées », résume celui qui a coprésidé la commission Bouchard-Taylor avec le philosophe Charles Taylor.
Issu d’une famille modeste, il a terminé sa maîtrise en sociologie à l’Université Laval en pleine Révolution tranquille, et son doctorat en histoire sociale, à Paris, au cœur de la révolte étudiante de Mai 68.
« C’était une période d’effervescence absolument extraordinaire. »
— Gérard Bouchard, historien et sociologue
Toute la société était à refaire.
Les changements se bousculaient, et la population, en mal de repères, se tournait vers les intellectuels, qui étaient régulièrement invités sur les plateaux de télévision et dans les émissions de radio.
« Pensez à Fernand Dumont, Guy Rocher, Léon Dion et Gérard Bergeron. Ils étaient extrêmement sollicités. On les voyait tous les jours dans les journaux », raconte-t-il.
À l’université, les facultés de sciences humaines et sociales étaient en plein essor. Il y avait des bourses et des emplois pour tous ceux qui en avaient les compétences. « On fondait un espoir, peut-être un peu naïf, dans le savoir de cette génération », note M. Bouchard.
Mais les temps ont changé.
Le savoir social a perdu de son prestige au profit de disciplines « plus appliquées, plus concrètes, plus pratiques, comme si elles étaient supérieures ».
Pourtant, les sciences humaines et sociales sont essentielles. Elles « aident les décideurs à faire des choix plus judicieux et les citoyens à voir plus clair dans ce qui se passe autour d’eux », souligne Gérard Bouchard.
Depuis quelques années, le monde traverse une période d’incertitude « considérable ».
Le clivage s’exacerbe, des « démocraties autoritaires » émergent et la désinformation circule à la vitesse de la lumière… C’est sans compter l’impact de l’intelligence artificielle sur l’organisation de la société, des écrans sur le développement du cerveau des enfants et des réseaux sociaux sur la socialisation.
« Est-ce qu’on se sent aussi armés ? Je ne crois pas qu’on a une conscience et une connaissance de ce qu’il faut faire pour régler les problèmes autant que nous les avions dans les années 1960 ou 1970. »
— Gérard Bouchard, historien et sociologue
Certes, il y a bien des professeurs qui étudient les défis sociaux de notre époque, mais ils le font avec des moyens largement insuffisants, alors que l’urgence de la situation appelle à lancer des « collaborations massives, interuniversitaires avec d’importantes équipes de chercheurs ».
Il faut investir davantage dans ces disciplines et « donner du prestige à ces professions, que les jeunes soient attirés à les pratiquer », plaide M. Bouchard.
« Est-ce que ce serait gaspillé étant donné la nature des problèmes ? C’est ça qui m’étonne, comme si on ne voyait pas la gravité des sujets sur lesquels nous travaillons. »
