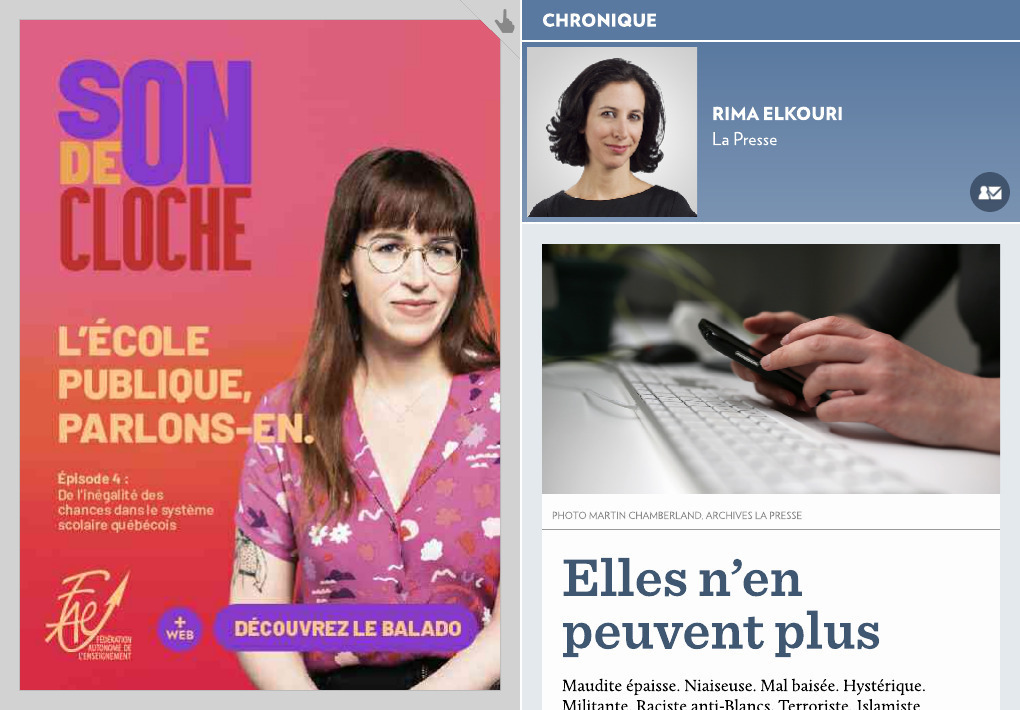Elles n’en peuvent plus
Maudite épaisse. Niaiseuse. Mal baisée. Hystérique. Militante. Raciste anti-Blancs. Terroriste. Islamiste radicale…
C’est le genre de sympathiques commentaires qui font partie de mon quotidien depuis que je fais de la chronique. Avec les réseaux sociaux, c’est pire que jamais et ça s’accompagne parfois de menaces.
Tout indique que je ne suis pas la seule. Au Québec comme ailleurs, les femmes journalistes et les politiciennes sont, de façon disproportionnée, la cible de cyberviolence et de désinformation. Diffamation, fausses histoires tapies de misogynie et de stéréotypes, insultes, sexualisation, menaces de violences physiques ou sexuelles… Pour celles qui sont issues de minorités, c’est pire encore. Et les conséquences sur la vie démocratique, très graves. Une étude récente de l’UNESCO décrit le phénomène comme une « effrayante marée » de violence qui exige de façon urgente que l’on s’y attarde.
« Certaines femmes n’en peuvent plus. Plusieurs vont quitter la vie politique ou le journalisme. D’autres vont décider de ne pas du tout se lancer dans ce milieu par peur », me dit Marie Lamensch, coordonnatrice au Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies de l’Université Concordia, qui rendra public un rapport sur le sujet, jeudi. Une réflexion qui tombe à point, au moment où Ottawa planche sur un ambitieux projet de loi pour mettre au pas les géants du web et que la marée monte encore.
J’ai moi-même participé à l’un des panels ayant mené à ce rapport qui à la fois dresse un état des lieux, tente de comprendre les racines du phénomène et de trouver des solutions. Et je me suis entretenue avec l’une des auteures du rapport, la professeure à l’Université George Washington Kristina Wilfore, cofondatrice de #ShePersisted, une initiative transnationale visant à lutter contre la désinformation sexiste et les attaques en ligne contre les femmes en politique.
« Tu n’as qu’à les ignorer ! », dit-on souvent aux femmes qui subissent de la violence en ligne. Mais ignorer un problème ne le fait pas disparaître. S’imaginer que c’est inévitable, non plus.
Le sexisme visant les femmes qui tentent de prendre leur place dans l’espace public n’est pas une fatalité. C’est une dangereuse stratégie politique, note Kristina Wilfore.
Le but ? Remettre en question les droits des femmes et la démocratie elle-même. Assigner au silence celles qui remettent en question le statu quo.
En ce moment, les mouvements de résistance contre les régimes autoritaires et les inégalités qui ont le plus de succès sont dirigés par des femmes, souligne la professeure. « Qu’il s’agisse de l’opposition en Biélorussie ou du mouvement Black Lives Matter, ce n’est pas un hasard. Par conséquent, les attaques visant à affaiblir les femmes ne sont pas non plus le fruit du hasard. »
Si certaines hésitent à dénoncer publiquement ces attaques, de peur d’aggraver le problème, d’avoir l’air faible ou d’être accusées de jouer à la victime, Kristina Wilfore y voit une stratégie efficace pour déconstruire le bon vieux stéréotype même sur lequel s’appuient ces attaques – l’idée que les femmes ne sont pas des leaders crédibles et compétentes.
« Des études dans le contexte américain montrent que la réponse d’une candidate au sexisme est vue par les électeurs comme une démonstration de son leadership et de son éligibilité, plutôt que comme quelque chose qui fragilise cette perception. »
C’est une bonne stratégie, mais ça ne peut évidemment pas se substituer à une stratégie politique globale. On ne réglera pas ce problème au cas par cas, en faisant reposer ce fardeau sur les seules épaules de celles qui le vivent.
* * *
Alors que faire ? Il est faux de penser que l’on n’y peut rien. Parce que c’est l’époque, parce que le problème est hors de contrôle, parce que c’est le prix à payer pour la liberté d’expression, parce qu’il y aura toujours du sexisme…
Aborder l’enjeu sous cet angle, c’est faire fausse route et en minimiser la gravité, observe Kristina Wilfore. « Ce qui m’a vraiment choquée en écoutant les femmes qui participaient aux panels canadiens et qui parlaient de leur expérience, c’est qu’on avait là des femmes bien en vue qui disaient : “Jamais plus je ne me présenterai en politique ! Je découragerais même des femmes d’y aller.” »
C’est notamment ce qu’a dit l’ex-journaliste et ex-politicienne de Vancouver Tamara Taggart, qui a quitté la vie publique après avoir reçu des menaces. « Je ne me soumettrai plus jamais, jamais, à cela. Cela a nui à ma santé mentale. J’ai eu peur pour la sécurité de ma famille. Cela m’a fait craindre pour ma sécurité. »
La députée Christine St-Pierre a confié de son côté que si elle était aujourd’hui une jeune politicienne, elle hésiterait à se lancer, vu la violence des réseaux sociaux.
« Si l’expérience est aussi pénible et dommageable, il s’agit d’une situation de crise », constate Kristina Wilfore.
On ne peut pas prendre le sujet à la légère.
« Dans certains cas, devant certaines menaces, on parle de questions de vie ou de mort. On ne peut pas juste dire aux femmes : “Endurcissez-vous ! Vous pouvez faire face aux attaques ! C’est dans l’ordre des choses !” »
— Kristina Wilfore, professeure à l’Université George Washington et cofondatrice de #ShePersisted
« Nous avons plutôt besoin d’un environnement favorable dans lequel ces femmes qui prennent part à la vie publique peuvent être soutenues et protégées. »
Les discours extrémistes et la désinformation qui pullulent dans les réseaux sociaux ne sont pas des accidents de parcours. C’est un fonds de commerce pour les Facebook et Twitter de ce monde. Ces entreprises ne sont pas de simples relayeurs de contenu, neutres et inoffensifs. « Elles encouragent des contenus qui servent leurs intérêts commerciaux. Elles doivent donc avoir une plus grande responsabilité quant aux préjudices qu’elles aggravent. »
Dans un tel contexte, le message à envoyer aux gouvernements est : « Faites votre job ! »
Si l’égalité et la démocratie leur tiennent vraiment à cœur, les gouvernements peuvent tout à fait créer un cadre législatif permettant de mettre au pas les réseaux sociaux. Ils doivent les contraindre à revoir leur dangereux modèle d’affaires.
« Nous devons nous pencher sur le fait que l’extrémisme est rentable et faire en sorte que ce ne soit plus le cas. »
Car ce qui est rentable pour les colporteurs de haine n’est que ruine pour la démocratie.
Un problème endémique
73 %
des femmes journalistes interrogées par l’UNESCO affirment avoir été victimes de violence en ligne dans le cadre de leur travail. Ce taux monte à 81 % pour les femmes noires, 86 % pour les femmes autochtones et 88 % pour les femmes de confession juive.
20 %
rapportent avoir été attaquées ou agressées dans leur vie réelle dans la foulée d’épisodes de violence en ligne. Ce taux bondit à 53 % chez les femmes journalistes arabes.
42 %
des femmes parlementaires ont vu des images d’elles extrêmement humiliantes ou sexualisées dans les réseaux sociaux, incluant des photomontages les montrant nues.
96 %
des images « deep fakes » en ligne mettent en scène des femmes, le plus souvent connues, dans des images de pornographie non consensuelle.
Sources : UNESCO ; Union interparlementaire ; Deeptrace Labs