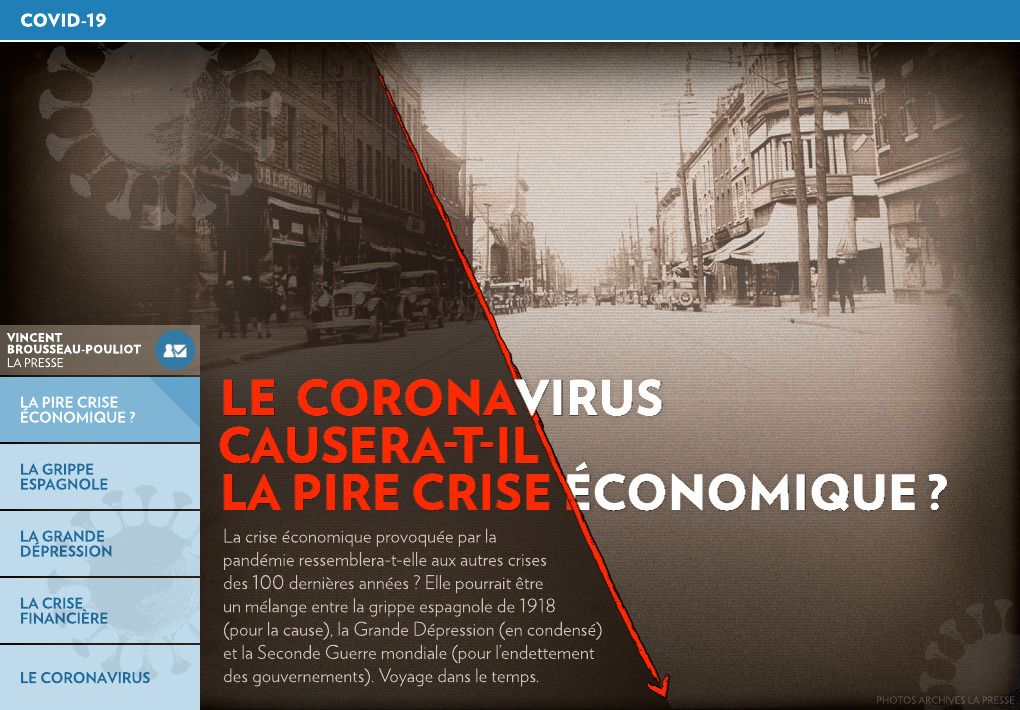La Grande Dépression commence le « jeudi noir », le 24 octobre 1929, sur le parquet de la Bourse de New York. En cinq jours, le principal indice boursier, le Dow Jones, perd 28 % de sa valeur.
Et ce n’est malheureusement que le début. En quatre ans, l’indice Dow Jones perdra 90 % de sa valeur. Il faudra attendre 25 ans, au milieu des années 50, avant qu’il revienne à son niveau de septembre 1929.
Mais surtout, le pire est à venir pour la population. Celle-ci passera les prochaines années dans un contexte de dépression économique. Car après une décennie de spéculation boursière et de croissance économique folle, le krach boursier entraîne toute l’économie occidentale en dépression.
Le Québec n’y échappe pas. La province exporte ses pâtes et papiers aux États-Unis et exporte le blé de l’ouest du pays en Europe. La demande pour ses produits est en chute libre en raison de la dépression économique. « On avait multiplié les usines de pâtes et papiers, et il y avait trop de papier pour les besoins de l’économie », dit Paul-André Linteau, professeur émérite d’histoire à l’UQAM.
En moins de quatre ans, l’économie canadienne se contracte de 28 %. Du jamais-vu à l’époque. Et encore aujourd’hui, même pour le coronavirus, les économistes prévoient que l’économie du Canada se contractera de 6,4 % à 12 % cette année, avant de croître à nouveau en 2021.
L’économie canadienne atteint le fond du baril en 1933. Le taux de chômage s’élève à 19 % en 1933, six fois plus qu’avant la crise. À Montréal, il est estimé entre 25 % et 33 %, selon certains historiens. La situation du chômage est la pire de l’histoire du pays.
Le portrait est encore pire aux États-Unis, principal client du Canada pour ses exportations : les Américains voient leur économie se contracter de 45 % en quatre ans, et leur taux de chômage officiel atteint 25 % en décembre 1932.
Comme l’assurance-chômage n’existe pas – le programme sera créé par Ottawa en 1940 –, les gouvernements et les villes donnent plutôt du travail aux chômeurs en finançant des programmes de travaux publics. C’est la version canadienne du New Deal du président des États-Unis de l’époque Franklin Roosevelt. À Montréal, on construit ainsi le chalet du mont Royal, le marché Atwater, le Jardin botanique.
Pour payer ces travaux, les gouvernements s’endettent. À Ottawa, la dette fédérale atteint 68 % de la taille de l’économie – un record qui ne sera battu que durant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40.
La Grande Dépression amène aussi les villes à fournir une aide directe aux chômeurs, un nouveau concept. À l’époque, chaque personne apte à travailler doit le faire, et l’aide aux personnes démunies est l’affaire des sociétés de charité dirigées par les communautés religieuses, comme la Société de Saint-Vincent de Paul. Très vite, les sociétés de charité sont dépassées par la situation.
« Certains organismes refusent de donner de l’argent aux chômeurs de peur que les gens le gaspillent, donc ils donnaient des coupons à l’épicerie. C’était un système très désorganisé basé sur le bénévolat. »
— Paul-André Linteau, professeur émérite d’histoire à l’UQAM
Devant pareille situation, Montréal crée la commission du chômage, l’ancêtre de l’aide sociale, en 1932. Pour financer ces dépenses, la Ville de Montréal s’endette, mais va aussi chercher des revenus avec une nouvelle taxe à la consommation.
L’économie reprend du galon à partir de 1934 (+ 10 % de croissance en 1934, + 7,2 % en 1935). Mais les familles québécoises ne retrouvent pas leur niveau de vie des années 20 : en fin de compte, les salaires stagneront durant la décennie. Une famille québécoise gagnait en moyenne 1529 $ en 1921, 1391 $ en 1931 et 1424 $ en 1941.
Une guerre « pour repartir l’économie »
En 1939, l’économie canadienne est revenue à son niveau d’avant le krach boursier quand survient un autre bouleversement majeur : la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe. En six ans, le conflit armé provoquera la mort de 65 millions de personnes.
Mais au Canada, loin du front européen, la guerre est bénéfique pour l’économie. Celle-ci croît à des niveaux records : + 13 % en 1940, + 13 % en 1941 et + 18 % en 1942. Les salaires, eux, augmentent de 66 % en cinq ans.
« Comme l’Angleterre est constamment bombardée par l’Allemagne, on décide qu’une partie de la production des tanks, des obus, des navires et du matériel militaire se fera au Canada. C’était très payant, dit Paul-André Linteau, professeur émérite d’histoire à l’UQAM. Par après, on entendait les gens de cette génération dire [quand il y avait une récession] : “Ça nous prendrait une guerre pour repartir l’économie.” »
L’un des symboles du boom économique de la Seconde Guerre mondiale : les « shops » Angus, l’une des plus importantes usines de Montréal. Depuis 1904, le Canadien Pacifique construit des wagons de train dans cette usine de 200 acres dans l’est du quartier Rosemont. Mais l’activité ferroviaire a ralenti durant la Grande Dépression, et le CP n’y produit presque plus de nouveaux wagons à la fin des années 30. La guerre redonne toutefois un élan aux usines Angus : 12 000 personnes y construiront des chars militaires pour les Alliés durant la guerre.
De nombreuses autres usines de Montréal décimées par la Grande Dépression reprennent aussi leurs activités. « Le besoin de main-d’œuvre est tellement important qu’on engage des adolescents de 15 à 17 ans. Beaucoup de femmes travaillent dans les usines de munitions, des femmes célibataires, mais aussi des femmes mariées. Du jamais-vu à l’époque », dit Magda Fahrni, professeure d’histoire à l’UQAM.
Au Canada, les gouvernements s’endettent pour fournir du matériel de guerre : le déficit fédéral annuel explose, la dette double.
En raison de la rareté de certains produits, le gouvernement impose un rationnement. « Pour bien des familles, les conditions de vie durant la guerre, même avec le rationnement, étaient meilleures que ce qu’elles pouvaient se payer durant la crise [des années 30] », dit Paul-André Linteau.
Les Québécois gagnent des salaires élevés pour l’époque, dépensent peu et épargnent beaucoup. Résultat : à la fin de la guerre, il y aura une récession relativement légère de deux ans, mais les Québécois ont de l’argent à dépenser. C’est le début de la société de consommation.