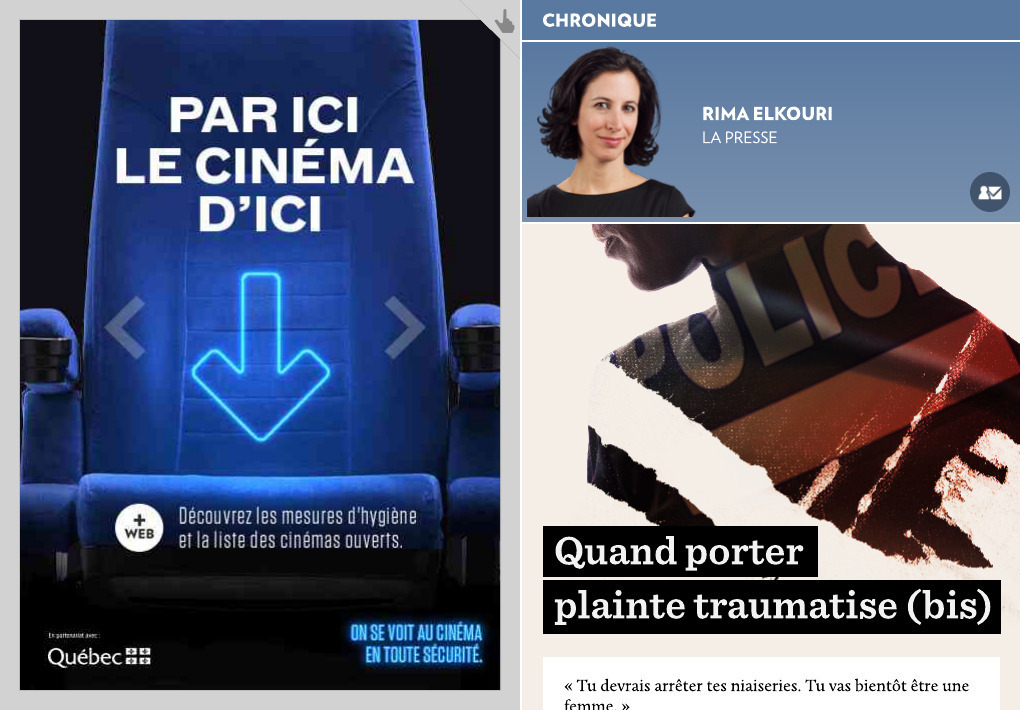Quand porter plainte traumatise (bis)
« Tu devrais arrêter tes niaiseries. Tu vas bientôt être une femme. »
Elle ne se rappelle pas le nom de l’enquêteur.
Mais elle se rappelle ces mots accusateurs qu’elle a reçus comme des coups de couteau.
C’était en 2010. Amanda, aujourd’hui étudiante en travail social, n’avait que 16 ans. Après un viol, elle a fait ce qu’on dit aux victimes de faire : porter plainte à la police. Accompagnée de son père, elle s’est rendue au bureau des enquêtes criminelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L’enquêteur chargé de son dossier était très froid. Elle ne sentait pas une once d’empathie chez lui. Elle était extrêmement mal à l’aise de lui raconter ce qu’elle avait subi. Extrêmement mal à l’aise lorsqu’il lui a demandé de mimer devant lui la position dans laquelle elle avait été agressée. Elle voulait disparaître.
Après avoir recueilli son témoignage et des éléments de preuve, l’enquêteur lui a dit qu’elle avait peu de chances de gagner sa cause. « Est-ce que tu veux quand même poursuivre ? »
Devant un enquêteur qui ne semblait même pas la croire, elle n’en voyait pas l’utilité. « Moi, je voulais d’abord être crue. »
Non seulement elle ne l’a pas été, mais en plus, l’enquêteur l’a blâmée pour son agression en lui disant d’« arrêter [s]es niaiseries ». « J’étais humiliée. » Comme si c’était elle et non son violeur qui était coupable. Comme si sa parole ne valait rien.
Pendant des années, elle a tenté d’enfouir tout ça dans un tiroir de sa mémoire fermé à double tour. Le hasard a fait que le tiroir s’est ouvert subitement un jour d’avril 2017 quand elle est tombée sur une de mes chroniques intitulée « La vérité sur les ‘‘fausses’’ plaintes ». « Ça m’a rappelé comment je n’avais pas été crue. »
À défaut d’obtenir justice, elle a réalisé qu’il lui fallait aller chercher de l’aide. Elle a alors entrepris des démarches avec un CALACS (centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), fait une demande auprès de l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) et entamé un suivi avec une psychologue.
Pire que l’agression, il y a la revictimisation que lui a fait subir la police, dit la jeune femme. Elle en garde encore des séquelles. Dépression, cauchemars, peur de recroiser ses agresseurs, perte de confiance… Un traumatisme qui n’est pas étranger au fait qu’elle a elle-même choisi d’étudier en travail social et de faire un certificat en victimologie. Pour tenter de faire la paix avec ce qui lui est arrivé et d’offrir à d’autres victimes l’aide qui ne lui a pas été offerte au moment où elle en avait le plus besoin.
« Ça m’a permis de comprendre que ce que j’avais vécu avec l’enquêteur, c’était une ‘‘victimisation secondaire’’ et que ça pouvait être parfois aussi pire que l’agression elle-même. »
— Amanda
***
Daniel, père d’Amanda, ex-cadre dans le domaine pharmaceutique, n’oubliera jamais dans quel piteux état était sa fille en sortant du bureau de l’enquêteur du SPVM. « Elle était dévastée. Fermée comme une huître », raconte-t-il, la voix brisée.
Dévasté, il l’était tout autant qu’elle. Car ce n’était malheureusement pas la première fois qu’elle tentait en vain d’obtenir justice après un viol. Deux ans auparavant, dans un party, elle avait été agressée sexuellement par deux hommes. Ses parents l’avaient aussitôt accompagnée au poste de police du quartier pour déposer une plainte. Un enquêteur – Amanda croit que c’est le même que celui qui l’a blâmée deux ans plus tard – a pris en charge le dossier. Des preuves ont été analysées, des témoignages recueillis, les deux suspects ont été dûment identifiés. L’un des suspects était déjà connu des policiers. Et puis, finalement, le choc et l’indignation lorsque l’enquêteur a convoqué le père pour lui dire que tout ça ne donnerait rien. Le procureur de la Couronne avait jugé que le dossier n’était pas assez solide pour déposer des accusations. Pas assez solide ? Avec des preuves, des témoignages et un suspect déjà fiché qui avait peut-être fait d’autres victimes ? Alors qu’on parle du viol d’une fille de 14 ans ?
L’indignation s’est doublée de rage lorsque l’enquêteur lui a servi une leçon de morale. « Il s’est penché vers moi et m’a dit : ‘‘Mais quel genre de père êtes-vous ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas protégé votre fille ? Vous devriez avoir honte de vous !’’ »
Le père, meurtri, est resté bouche bée. « Vous n’avez pas idée de la rage qui brûle en moi. Une rage aussi intense que le jour où j’ai quitté le bureau de ce détective. Lorsque l’on me demande si je crois au système de justice, je me contente de répondre simplement non, en prenant une respiration profonde. »
À la suite de ces expériences malheureuses, Amanda ne peut pas dire non plus que le système lui inspire davantage confiance. Mais le vent de changement qui souffle depuis quelque temps lui donne à croire que tout n’est pas perdu. « Il y a du travail à faire pour améliorer les choses. Au moins, on est déjà en train d’y voir. Des choses se mettent en place. Il y a plus de sensibilisation, que ce soit avec les mouvements qui libèrent la parole, les nouvelles politiques mises en place dans les cégeps et les universités qui incluent des formations obligatoires sur le harcèlement sexuel et le consentement…
« Moi, personnellement, à cause de ce qui m’est arrivé, j’ai perdu confiance. Mais je n’ai pas perdu espoir. »
Qu’en disent le SPVM et le DPCP ?
Bien qu’elle ne puisse commenter des cas particuliers, Christine Christie, inspectrice au service des enquêtes criminelles et commandante à la section des agressions sexuelles du SPVM, souligne que plusieurs améliorations ont été apportées depuis 2010 dans les enquêtes d’agressions sexuelles et que d’autres sont à venir l’automne prochain, avec la mise en place d’un processus encore plus rigoureux de révision des dossiers.
L’inspectrice Christie encourage les victimes qui estiment avoir été injustement traitées à déposer une plainte sur le site du SPVM. « Un dossier peut être rouvert et le dossier va être confié à un autre enquêteur. » Cette démarche n’est toutefois pas possible dans les cas où c’est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui ferme un dossier.
Depuis 2018, dans la foulée du mouvement #metoo, les ressources de la section ont été bonifiées afin d’offrir un meilleur accompagnement aux victimes. Déjà, depuis 2010, deux intervenantes du CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) travaillent en permanence dans les bureaux des enquêteurs. « Dès la réception de la plainte, le service est offert à la victime. »
Autre changement important : depuis quelques années, dans le processus de sélection des enquêteurs de la section, on accorde une attention particulière à la capacité d’empathie et aux aptitudes de communication interpersonnelle des enquêteurs. Depuis 2019, 73 % sont des femmes.
Du côté du DPCP, on précise aussi que, depuis 2018, les procureurs sont tenus de rencontrer systématiquement les victimes pour bien leur expliquer les raisons pour lesquelles ils refusent un dossier. Sans pouvoir commenter ce cas précis, Me Audrey Roy-Cloutier, procureure aux poursuites criminelles et pénales, indique que, de façon générale, le rôle du procureur est de prendre connaissance des dossiers remis par les enquêteurs et de voir ce qu’on peut prouver ou pas. Un dossier refusé ne signifie pas que l’on ne croit pas la victime. « On a deux grands thèmes à aborder : la suffisance de preuves et l’opportunité de poursuivre. »