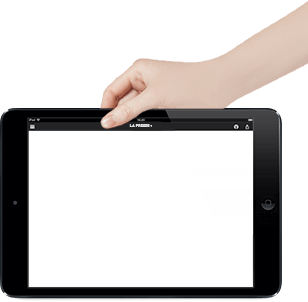Un vaccin avant l’atteinte de l’immunité de groupe ?
Il est peu probable que le Québec puisse atteindre le seuil d’immunité de groupe requis pour freiner définitivement la pandémie de COVID-19 avant qu’un vaccin ne soit mis au point.
C’est du moins l’avis du Dr François Desbiens, directeur de santé publique pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui se réjouit de constater que le premier ministre François Legault a minimisé au cours des derniers jours l’importance d’acquérir l’immunité collective.
M. Legault en avait fait grand cas la semaine dernière pour justifier l’ouverture prochaine des écoles.
« Il a même dit [lundi] que si l’immunité naturelle arrivait, ce serait un gain secondaire, mais que ce n’était pas la motivation première derrière la décision. Moi, je ne suis même pas certain qu’on aura ce gain secondaire », relève le Dr Desbiens.
« Je suis convaincu que les scientifiques et les pharmaceutiques vont nous sortir un vaccin avant », précise le spécialiste, qui salue la décision du gouvernement d’opter pour un déconfinement « graduel » et « modéré » plutôt que de laisser le virus « circuler comme il voudrait ».
Le maintien de plusieurs mesures de contrôle, dit le médecin, va empêcher qu’il ne se diffuse trop rapidement dans la société et crée une seconde vague d’infections et d’hospitalisations pouvant submerger le système de santé.
L’approche choisie signifie aussi qu’il faudrait longtemps pour atteindre le taux d’infection des deux tiers de la population requis, en l’absence d’un vaccin, pour que le virus ne puisse plus se propager.
La semaine dernière, le premier ministre québécois avait indiqué que l’ouverture des écoles permettrait « très graduellement » que les personnes moins à risque soient exposées au coronavirus, développent des anticorps et deviennent immunisées en contribuant du coup à une forme collective « d’immunité naturelle ».
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu le même jour qu’il n’existait pas encore de preuves scientifiques démontrant que les personnes infectées par le virus développaient une immunité durable contre le virus.
Ses dirigeants ont précisé par la suite qu’ils s’attendaient à ce que cette protection existe, mais que sa durée et son efficacité étaient inconnues, rendant périlleuse toute stratégie de déconfinement axée sur l’atteinte d’une forme d’immunité de groupe.
La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, a prévenu dans la même veine que « l’idée de générer une sorte d’immunité naturelle ne devrait pas être considérée » par les autorités sanitaires.
Le premier ministre québécois a fait écho à ces préoccupations lundi lors de l’annonce du plan de réouverture des écoles en assurant que le développement d’une forme d’immunité de groupe n’était pas un facteur dans sa décision d’aller de l’avant.
En conférence de presse, mardi, il a indiqué qu’il n’y avait pas de preuve que l’approche axée sur l’atteinte de l’immunité de groupe fonctionnait.
Moins de 10 %
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) avait rappelé lundi dans un rapport diffusé en soirée que le pourcentage de Québécois ayant déjà été infectés par le nouveau coronavirus était inférieur à 10 %, très loin du seuil de près de 70 % requis pour que le virus ne puisse plus se propager.
Même l’infection de l’ensemble des personnes de moins de 18 ans ne toucherait que 20 % de la population, ont relevé les chercheurs, en prévenant que l’infection subséquente de parents risquait d’entraîner une flambée de cas et d’hospitalisations très problématique pour le système de santé.
Ils ont évoqué les travaux passés de l’Imperial College de Londres témoignant des risques découlant d’une approche axée sur la propagation à grande échelle du virus afin de plaider, en conclusion, pour le maintien de mesures de distanciation physique « fortes » dans les écoles après leur ouverture.
Le gouvernement britannique a opté au début de la crise pour une approche axée sur l’atteinte du seuil d’immunité de groupe, mais s’est ravisé et a imposé un confinement à grande échelle après avoir pris connaissance du nombre de personnes qui risquaient de mourir.
Le modèle suédois
La Suède est l’un des seuls pays à ne pas avoir obligé sa population à se confiner, choisissant des mesures plus modérées susceptibles d’être maintenues plus longtemps dans le temps sans répercussions sociales aussi draconiennes.
L’efficacité de son approche continue de faire débat, incluant au sein du pays, qui présente un taux de mortalité sensiblement plus élevé que celui de pays scandinaves voisins ayant opté pour le confinement.
Les responsables de santé publique suédois se montrent satisfaits pour l’heure de la stratégie suivie.
Ils soulignent notamment que le tiers de la population de la capitale, Stockholm, voire plus, pourrait aujourd’hui être immunisé, ce qui aidera à freiner la progression future du coronavirus, même si le seuil critique des deux tiers n’a pas encore été atteint.