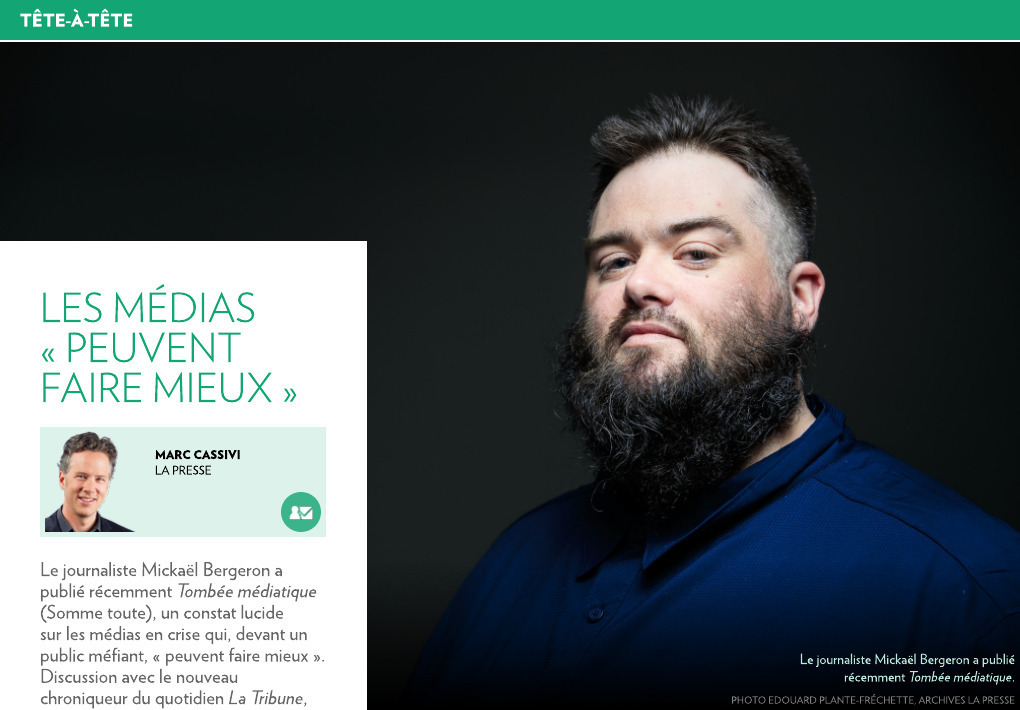Les médias « peuvent faire mieux »
Marc Cassivi (M.C.) : Tu parles dans ton livre du désamour et du désenchantement du public envers les médias. De ces gens qui se sentent laissés pour compte, à ton avis, parce que les salles de nouvelles sont trop homogènes, trop montréalocentristes et manquent de diversité, pas seulement culturelle. Tu dis que tu as un profil atypique : tu es autodidacte, tu as vécu de l’aide sociale, tu viens d’une classe sociale peu représentée dans les médias. Il faut selon toi que les médias soient plus représentatifs de ce qu’est la société de façon générale ?
Mickaël Bergeron (M.B.) : Oui, et je crois qu’on ne l’évoque pas assez souvent. On parle beaucoup de diversité culturelle, et ça va de soi qu’il faut faire des efforts pour qu’il y en ait davantage. Mais il y a d’autres formes de diversité qui manquent aussi : la diversité corporelle, la diversité de classes économiques, même la diversité d’accents ! Ça me fascine à quel point, par exemple à Radio-Canada, il y a des accents qui sont effacés. On va apprécier un accent français ou marocain, mais pas un accent du Saguenay ou de la Gaspésie. On veut que l’accent soit plus homogène et tende vers un « français international ». Lorsque je retourne dans ma famille, je me rends compte qu’on ne s’intéresse pas du tout aux mêmes médias. Je comprends pourquoi les radio-poubelles à Québec rejoignent un public qui ne se sent pas concerné par les autres médias.
M. C. : Tu abordes dans ton essai une question qui m’intéresse depuis un moment : la fameuse neutralité ou le devoir de réserve des journalistes. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué pendant la dernière campagne électorale américaine que les chefs d’antenne de CNN donnaient beaucoup plus leur opinion qu’il y a quatre ans. Ça bouscule ma manière traditionnelle de percevoir le journalisme. Tu écris : « La neutralité peut devenir complice des pires atrocités ». Je comprends ce que tu veux dire, mais tu comprends aussi mes réserves face à cette façon de faire ?
M. B. : Si on prend le cas de CNN, c’est une réponse directe à Fox News. Dans la mesure où CNN avait une culture objective et neutre et que c’est seulement en constatant que la chaîne perdait du terrain qu’elle a voulu se replacer vis-à-vis de Fox News, qui est très campée à droite. Je pense qu’il faut un mélange. J’en parle dans mon livre. Il faut qu’il y ait dans les médias des journalistes dont on ne sait pas où ils logent : Bernard Derome, par exemple, était-il fédéraliste ou indépendantiste ? Mais c’est bien aussi qu’il y ait des journalistes qui ne font pas semblant de ne pas avoir de biais et qui assument ce qu’ils sont.
M. C. : Je me demande parfois si la tradition française d’assumer sa place sur l’échiquier politique – Libération à gauche, Le Figaro à droite – n’est pas plus transparente vis-à-vis des lecteurs que l’objectivité dont se réclament traditionnellement la plupart des journaux en Amérique du Nord. On fait un travail honnête et rigoureux. On tend vers la neutralité. Mais l’objectivité pure est un leurre. Le modèle français est-il préférable, à ton avis ?
M. B. : Ce débat existe depuis longtemps. Je ne pense pas que d’afficher ses couleurs empêche d’être objectif. L’objectivité est plus un processus qu’un parti pris. On peut être honnête et objectif. Mais un journaliste n’est pas d’office objectif. Quand on est transparent avec le lecteur, il est moins surpris. Libération analyse une situation d’une autre manière que Le Figaro. Le lecteur sait à quoi s’attendre.
M. C. : Il sait où le média loge, de façon générale. Ce qui est moins clair au Québec…
M. B. : Au Québec, les médias se prétendent neutres, mais il y a souvent une couleur, qui est donnée par les chroniqueurs. Ce que je trouve dangereux, c’est que certains chroniqueurs se prétendent au-dessus de la mêlée. Ils observent et analysent la société de leur tour d’ivoire, avec une certaine distance, alors qu’ils en font partie. Je pense que c’est important de rester sur le même plancher des vaches que le public auquel on s’adresse. Les journalistes ne sont pas à part de la société.
M. C. : Y a-t-il à ton avis quelque chose de générationnel dans le regard qu’on porte sur l’objectivité journalistique ? J’ai 47 ans, je travaille depuis que j’ai 20 ans dans les médias traditionnels. Des journalistes plus jeunes comme toi, qui ont créé des médias, qui ont travaillé autant dans des médias traditionnels qu’alternatifs, ont souvent une perception différente. Ils ont moins peur d’afficher leurs partis pris ?
M. B. : Je pense que oui, même si je n’aime pas généraliser en parlant de générations. Surtout que je suis entre les deux. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier [il a travaillé autant à Radio-Canada à Sept-Îles qu’au Soleil et dans des médias moins grand public]. L’idéal de cette tradition journalistique est très beau, mais il y a une forme d’énergie chez les jeunes, et une volonté de rejoindre le public en leur racontant les choses différemment, qui est très intéressante. Souvent, les jeunes se placent autrement face à l’objectivité. Expliquer sa démarche, c’est très transparent. Et cette génération recherche cette transparence. Pourquoi je choisis tel sujet, pourquoi je l’aborde de telle façon, avec tel invité… On voit ça de plus en plus. Ça rappelle le journalisme gonzo. C’est propre aux plateformes qui rejoignent les jeunes dans la vingtaine et au début de la trentaine : les réseaux sociaux, YouTube et compagnie.
M. C. : Tu parles dans ton livre de cette fausse perception que les médias québécois sont gangrenés par la gauche en donnant un exemple éloquent : celui des gens des médias qui se sont lancés en politique et qui sont le plus souvent identifiés à droite. Ce qui me fait sourire, ce sont ces chroniqueurs qui sont souvent des militants plus que des journalistes, et qui sont les premiers à traiter des journalistes de militants pour tenter de les discréditer…
M. B. : Je trouve ça complètement ironique ! J’essaie de l’expliquer dans mon livre. Je ne vois pas la différence entre un chroniqueur très campé à droite dans ses idées économiques et un chroniqueur de gauche que l’on accuse d’être un militant écologiste. C’est accuser les autres de ce que l’on fait.
M. C. : Lorsque le point de vue que l’on défend est majoritaire et consensuel, on considère qu’il est neutre. Mais dès lors qu’on déroge au discours dominant, soudainement, on est militant…
M. B. : C’est exactement ça. On le voit très bien dans tous les débats sur le racisme. À partir du moment où un chroniqueur noir affirme que quelque chose s’apparente à du racisme, on l’accuse d’être militant. Une chroniqueuse qui dénonce le sexisme sera perçue comme une militante féministe, alors qu’un homme qui remet en question des positions féministes est un simple chroniqueur.
M. C. : Tu écris qu’il s’agit du « biais le plus sournois des journalistes : le statu quo n’est pas neutre. C’est aussi une prise de position ». Ceux qui défendent le point de vue dominant ne voient plus leurs propres partis pris et leurs biais inconscients.
M. B. : Dans des dossiers économiques, certaines personnes vont faire des propositions audacieuses, valides ou pas, et être discréditées par ceux qui prônent le statu quo et qui sont perçus comme étant neutres. Si le statu quo avait perduré depuis 200 ans, on n’aurait pas évolué !
M. C. : Comment, dans l’ère Trump, le journalisme va avoir changé, à ton avis ? Des journalistes américains font valoir que devant des gens qui vivent carrément dans un monde parallèle, qui mentent constamment, on ne peut plus appliquer les règles traditionnelles du journalisme. Le paradigme n’est plus le même.
M. B. : Toute cette vague de vérifications des faits, le travail que font les Décrypteurs à Radio-Canada, Jean-François Cliche au Soleil ou encore l’Agence Science-Presse, est là pour rester. Avec toute la désinformation, peut-être qu’on est devenus plus vigilants, et c’est tant mieux.
M. C. : Peut-être que Trump aura été un électrochoc nécessaire pour qu’on se questionne davantage sur nos façons de faire. À la fin de ton livre, tu dis espérer que les médias retrouvent leur crédibilité. On a perdu un certain public en cours de route. Peut-on le récupérer, selon toi ?
M. B. : Je pense que oui, même si les choses ne seront plus les mêmes sans doute. Comment le modèle va évoluer ? Combien de médias vont réussir à survivre à moyen et long terme ? Il faudra revoir toutes nos façons de faire.
Tombée médiatique – Se réapproprier l’information
Mickaël Bergeron
Éditions Somme Toute
240 pages