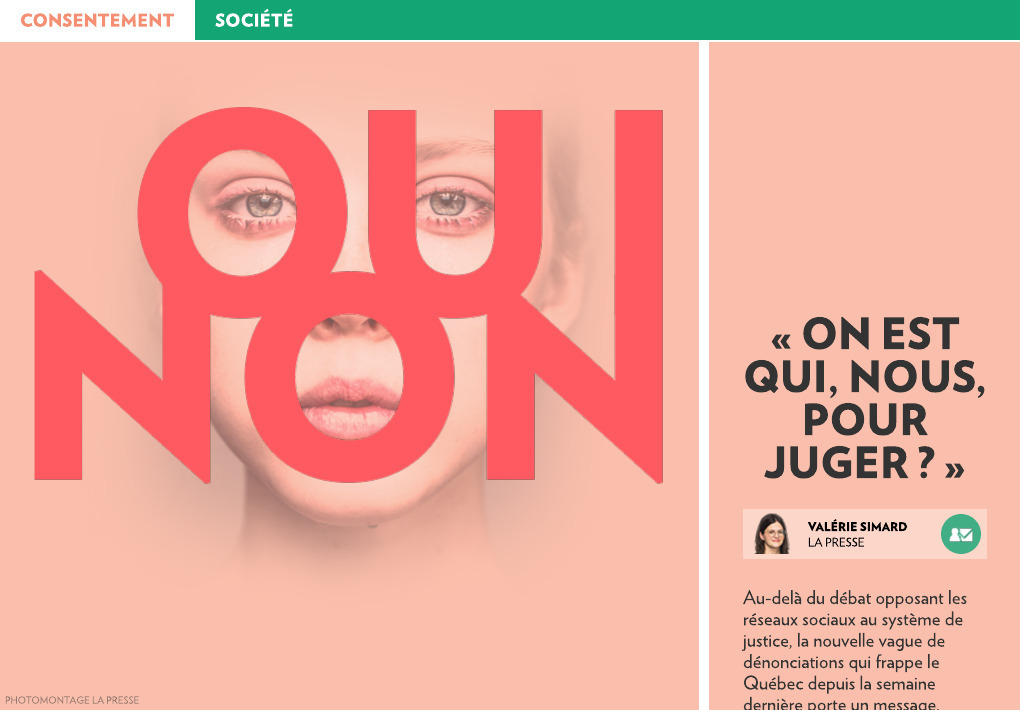« On est qui, nous, pour juger ? »
« On est qui, nous, pour juger du niveau de souffrance d’une personne ? », interroge la psychoéducatrice et autrice Stéphanie Deslauriers. Deux personnes peuvent vivre exactement le même évènement, mais en être affectées de différentes façons, ajoute-t-elle.
« Dans la vie, dans la journée d’une femme, il peut se passer plusieurs agressions et, souvent, elles passent sous le radar, elles sont banalisées, normalisées. Voilà ce que ça dit, tous ces récits », affirme la sociologue Sandrine Ricci, chargée de cours et doctorante en sociologie et en études féministes à l’UQAM.
« Un harcèlement verbal dans la rue, qui pourrait être caractérisé de mineur, peut avoir un impact majeur parce qu’il réactive des traumatismes d’une agression antérieure, par exemple. »
— Sandrine Ricci, sociologue
Kharoll-Ann Souffrant, étudiante au doctorat en service social à l’Université d’Ottawa, a dénoncé son agresseur, sans toutefois le nommer, dans une lettre ouverte publiée le 10 juillet dernier dans la section Débats de La Presse. S’adresser à la justice n’aurait, selon elle, pas répondu à ses besoins en tant que victime.
« Je voulais vraiment participer au débat public et que les choses changent dans la société, explique-t-elle. Mettre un visage sur les femmes noires qui vivent cette violence parce qu’on est effacées de ces discussions-là, montrer les impacts que ça avait eus, amener des pistes de solution auxquelles on pourrait réfléchir collectivement. »
Elle explique l’écho positif et les messages de soutien qu’elle a reçus à la suite de son témoignage par le côté classique de son agression sexuelle, dans l’imaginaire collectif. « Ce qui est arrivé à Safia Nolin [morsure à la cuisse, avances sexuelles non sollicitées], pour moi, c’est une agression sexuelle, même si, pour les autres, ça peut ne pas être grave ou moins grave, déclare Kharoll-Ann Souffrant, à propos des allégations qu’a faites la chanteuse contre l’animatrice Maripier Morin. Ce n’est pas la bonne approche de parler de ça en termes de gravité parce qu’on ne sait pas ce que la personne a vécu avant qui peut faire en sorte que ça l’affecte autant. »
« Un des grands gains par rapport à la lutte contre les violences sexuelles a eu lieu dans les années 80, quand les féministes ont réussi à faire en sorte qu’on ne parle plus de viol complété, mais d’agressions, pour démontrer que c’est un spectre », souligne la cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles, Mélanie Lemay, qui a elle-même été victime d’une agression sexuelle qu’elle a dénoncée, à la fois à la police et sur la place publique.
Un appel aux changements de comportement
Il y a, dans ce flot de dénonciations, une volonté des victimes de se faire entendre pour que, oui, des changements soient apportés au système de justice quant au traitement des plaintes liées aux agressions sexuelles, mais aussi un appel aux changements de comportement.
« C’est juste la pointe de l’iceberg qui se retrouve dans les médias, mais c’est comme une validation du caractère absolument inacceptable de ces gestes-là. »
— Manon Bergeron, professeure de sexologie
En 2016, la professeure du département de sexologie de l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche interdisciplinaire et intersectorielle sur la violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur a dirigé l’enquête ESSIMU (Sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire), menée auprès des étudiants et employés de six universités québécoises francophones. Près de 37 % des répondants ont déclaré avoir vécu une forme de violence sexuelle dans leur environnement de travail ou d’études. Mais plusieurs ne le reconnaissaient pas comme tel.
« Quand les gens ont vécu une expérience qui ne ressemble pas au cliché de l’agression sexuelle, c’est comme si c’était moins grave et que ça ne valait pas la peine de dénoncer, expose Manon Bergeron. Alors, aujourd’hui, ce qu’on voit, ce sont des récits similaires à ce qu’on a eu dans les récits ESSIMU et là, je pense qu’il y a une validation, une reconnaissance que tous ces gestes-là, même s’ils ne rencontrent pas les critères du Code criminel au niveau des agressions sexuelles, ça demeure des violences sexuelles. »
Pourquoi les réseaux sociaux ?
Bien que très critiquée par le milieu juridique, l’utilisation des réseaux sociaux pour dénoncer des agresseurs allégués n’étonne pas, d’autant plus que cette vague de dénonciations est pour une grande part menée par des jeunes. « Le fait d’amener des personnes sur la place publique, avec leur nom, c’est très risqué, note Kharoll-Ann Souffrant. Il peut y avoir des poursuites en diffamation. C’est comme si ces jeunes se disent qu’ils n’ont plus rien à perdre, comme si la société n’en a pas fait assez pour les protéger, alors on dit : on va prendre [le risque], on va se protéger nous-mêmes. »
« Elles sont allées là où elles sont habituellement, là où elles retrouvent certaines formes de soutien. »
— Manon Bergeron
Manon Bergeron ajoute que c’est aussi une façon de montrer qu’il ne s’agit pas d’un problème individuel, mais collectif.
C'est aussi une façon de rompre la solitude, en temps de pandémie, selon Sandrine Ricci. Elle précise qu’il n’est pas avéré que les gens qui dénoncent sur les réseaux sociaux ne se sont pas également tournés vers le système de justice, le nombre d’agressions sexuelles signalées à la police ayant augmenté, au Québec, comme dans le reste du Canada, en 2017 et 2018, après le mouvement #moiaussi, selon des rapports de Statistique Canada. Elle voit également dans cette prise de parole une volonté des victimes de reprendre du pouvoir sur leur récit. « Un des problèmes avec le système judiciaire ici, c’est qu’on leur retire ce pouvoir », note-t-elle.
« Ce n’est pas anodin, ce à quoi on assiste en ce moment, parce que dans les dernières années, quand on a tenté de démontrer qu’il y avait un problème avec le système de justice, on nous a noyés en disant qu’il y avait eu des formations, que tout fonctionne bien, qu’il y a eu des refontes majeures dans la justice dans les dernières années. Mais si c’était vraiment ça, la réalité, on n’aurait pas eu cette vague-ci », souligne Mélanie Lemay.
Des trémolos dans la voix, elle raconte comment sa vie a été brisée le jour de son agression, survenue en 2013, et une deuxième fois, lorsque les policiers lui ont demandé de mimer son viol. « La raison pour laquelle je témoigne, c’est que ma vie a complètement déraillé, mais si, au moins, je peux m’assurer que les prochaines générations, de mes nièces et toutes les autres filles qui vont venir après moi, puissent, si ça leur arrive, ne pas avoir à se battre en plus contre le système. » Dimanche midi, elle participera à une manifestation contre les violences sexuelles qui se tiendra au parc La Fontaine à Montréal. « C’est une autre génération qui est en train de se lever en ce moment comme porte-parole du mouvement. » Et elle trouve cela fort encourageant.