Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 10 décembre 2022,
section ACTUALITÉS, écran 2


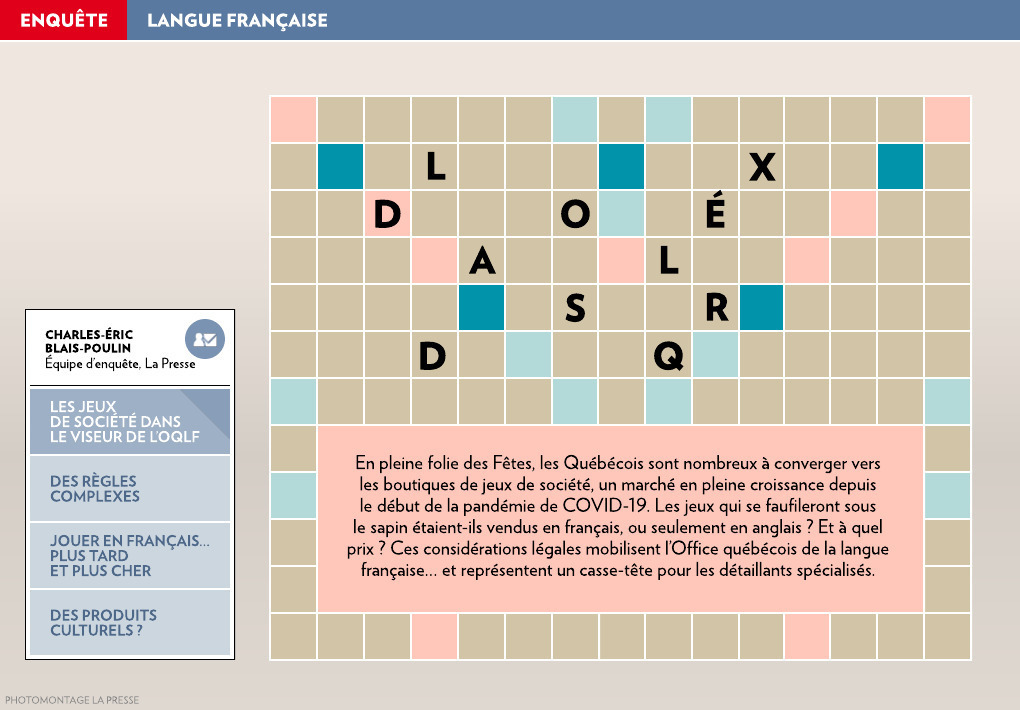
Le jeu de plateau Star Wars Villainous – Power of The Dark Side a tous les atouts d’un succès de vente : un éditeur allemand réputé, Ravensburger, des antihéros d’une franchise hollywoodienne à succès, Star Wars, et des mécanismes grand public.
Mais selon la Charte de la langue française, aucun exemplaire du jeu ne peut être vendu par un commerçant qui a pignon sur rue au Québec ou qui y livre. Pourquoi ? Parce que la boîte, les cartes de jeu et les règles ne sont éditées qu’en anglais.
En cause, l’article 54 : « Sont interdits sur le marché québécois les jeux […] dont le fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que français, à moins que […] le jeu n’y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables. »
En clair, un jeu en version anglaise peut uniquement être écoulé au Québec au côté de son pendant en français. Bien sûr, presque toutes les boutiques de jeux spécialisées de Montréal ont – ou ont eu – Star Wars Villainous en stock, au mépris de la Charte.
Des centaines de jeux comme 18 Holes, Here to Slay, Lords of Waterdeep ou encore la série Legendary se trouvent eux aussi sur plusieurs étagères d’ici, bien qu’aucune traduction ne soit proposée. Même Prelude to Rebellion, imaginé par le Québécois Marco Poutré autour de la rébellion des Patriotes, n’est pas traduit dans la langue de Louis-Joseph Papineau, et est donc interdit de vente dans le – jadis – Bas-Canada.
« C’est bien beau sur papier quand des lois sont écrites à l’Assemblée nationale, mais ça ne tient pas compte de la vraie réalité du marché », regrette Anthony Doyon, copropriétaire et directeur des opérations des cinq boutiques L’Imaginaire.
Dans les derniers mois, la chaîne de magasins a reçu la visite d’inspecteurs de l’Office québécois de la langue française (OQLF) à la suite d’une plainte. Les pubs ludiques Randolph et la boutique La Pioche, à Québec, font quant à eux l’objet d’une « démarche de francisation » encadrée par l’organisme.
Pour les commerçants spécialisés, qui se grisent de jeux rares et étrangers, l’article 54 est un véritable casse-tête.
« Il y a des choses que je peux changer et je vais me conformer avec plaisir. Mais je ne peux pas traduire des jeux sur lesquels je n’ai pas les droits. »
— Anthony Doyon, copropriétaire et directeur des opérations des cinq boutiques L’Imaginaire
Le premier plan présenté par L’Imaginaire à l’OQLF pour se plier à la Charte a été refusé. Le détaillant doit revenir à la charge d’ici la mi-décembre, en pleine folie des Fêtes. « Après, on pourrait ne plus avoir le droit d’avoir des subventions provinciales ou de postuler à certains contrats du gouvernement du Québec, par exemple pour vendre dans les bibliothèques. »
« Un marché ouvert »
Bien que Randolph n’ait pas été visée par une plainte, l’entreprise – qui possède sept pubs ludiques en plus d’être éditeur, détaillant et distributeur – a reçu la visite d’un conseiller de l’OQLF à deux reprises l’an dernier. Là encore, cette même menace : la déqualification de certaines aides publiques à défaut de mener un « programme de francisation ».
Les pubs Randolph entendent se conformer à l’article 54, parce que leur rentabilité dépend d’abord de la vente d’alcool, souligne leur directeur, Martin Montreuil. Le coactionnaire a beau afficher son parti pris pour la langue française dans la balado De l’autre côté du plateau, il juge néanmoins les dispositions de la Charte « difficilement applicables » et nettement défavorables aux petits détaillants.
« Des 4600 jeux qui sont sortis l’année dernière, il y en a peut-être 10 % qui sont sortis d’abord en français. Ça devient, pour les commerçants, très difficile de compétitionner contre un marché qui est rendu de plus en plus ouvert, de plus en plus “internet”. »
— Martin Montreuil, directeur et coactionnaire des pubs ludiques Randolph
Le risque de l’exode
Le respect strict de la Charte priverait les Québécois de nombreuses œuvres étrangères, que ce soit en raison d’une production unilingue à petite échelle ou des délais de traduction, qui atteignent parfois jusqu’à trois ans.
« Plusieurs étagères seraient malheureusement vides, dit Anthony Doyon, des succursales L’Imaginaire. Je ne pense pas que c’est ça qui va faire en sorte que la langue française va être mieux représentée au Québec et que nos concitoyens vont être mieux servis. Ils vont juste s’en retourner, puis aller dépenser leur argent en Ontario ou en Colombie-Britannique. »
Nombre de ludophiles d’ici convergent déjà vers des commerces en ligne ontariens ou des plateformes comme Amazon et eBay, qui se moquent bien de la Charte. L’OQLF est pourtant clair : « Les entreprises qui vendent, distribuent ou rendent disponibles au Québec par un moyen technologique comme un site web des produits, même provenant d’un tiers hors Québec, sont soumises à la loi. »
Des boutiques montréalaises comme Dice Owl ou Chez Geeks compétitionnent ouvertement dans le marché anglophone. Leur site affiche peu ou pas de contenu en français. Chez BoardGamesNMore, commerce en ligne qui mène ses activités à partir de Pierrefonds, c’est 80 % des stocks qui défient la Charte, de l’aveu même de sa propriétaire, Ruba S. « Tous nos clients sont anglophones et achètent des jeux en anglais, dit-elle. On a quelques jeux en français, mais on n’a ni la place ni l’argent pour en avoir beaucoup en stock. »
Changer de cible
Martin Montreuil, de Randolph, préférerait que l’OQLF sévisse au début de la chaîne de commercialisation. « Il faudrait plus aller vers les éditeurs en disant : “Rendez vos jeux disponibles en français dans le marché.” » Encore là, note-t-il, il y a un risque.
« On est tellement petits qu’on risque de nous ignorer et de ne plus commercialiser au Québec. »
— Martin Montreuil, des pubs ludiques Randolph
Entre autres exemples : Hasbro livre certains de ses jeux partout en Occident sauf au Québec.
Les éditeurs étrangers qui privilégient l’approche « états-unienne » et « tout à l’anglais » n’ont pas d’affaire au Québec, réagit Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français, organisme de défense et de promotion de la langue française. « Ces compagnies-là, si elles veulent s’intéresser à des marchés qui ne sont pas anglophones, bien, qu’elles le fassent dans le respect de l’environnement culturel. Ce n’est ni sorcier ni compliqué. »
Selon M. Perreault, qui appuie les démarches de l’OQLF, les établissements de détail qui proposent des jeux unilingues anglais « participent à la banalisation et à l’infériorisation de l’identité de leur marché et de leur clientèle ».
Il n’en demeure pas moins que les règles, dans les boîtes de jeu comme dans la Charte, sont parfois difficiles à suivre.
Imaginez un film polonais attendu par une enthousiaste communauté de cinéphiles. Des salles du Québec le présentent en version originale sous-titrée en anglais, mais patience : si les ventes sont bonnes, l’œuvre sera traduite en français… dans un an ou deux. Et les billets d’entrée coûteront jusqu’à deux fois plus cher !
Voilà le genre d’enjeux auxquels de nombreux joueurs doivent faire face. « La majorité des gens au Québec veulent acheter les jeux en français », assure Martin Lafrenière, vlogueur à la Zone jeux de société et coanimateur de la balado De l’autre côté du plateau. « Le problème, c’est que les boîtes, des fois, vont arriver un an, un an et demi, voire deux ans plus tard. »
Le ludophile a commandé un jeu en développement qui lui a finalement été livré, en français, deux ans et demi après la version originale, « une fois le buzz passé ».
« En tant que joueur, ça ne me tente pas d’attendre trois ans. »
— Martin Lafrenière, vlogueur à la Zone jeux de société et coanimateur de la balado De l’autre côté du plateau
Les raisons des délais – durant lesquels les versions anglaises sont « interdites » de vente au Québec – expliquent pourquoi les jeux édités en français coûtent plus cher : production à moindre échelle, traduction, transport, localisation (adaptation du jeu à la culture locale), ajout d’intermédiaires (éditeurs et distributeurs régionaux), etc.
« Souvent, la différence de prix ne vient pas du français, mais d’une chaîne commerciale qui n’a pas été réfléchie », constate Christian Lemay, fondateur de l’éditeur Scorpion masqué et auteur de jeux de société.
« Les tirages sont beaucoup moins importants, explique par ailleurs Martin Montreuil, copropriétaire de Randolph et animateur de la chaîne YouTube La société des jeux. D’imprimer 100 000 jeux en anglais ou d’en imprimer 10 000 en français, le prix ne sera forcément pas le même, donc ça crée une pression à la hausse. »
Concrètement ? Le jeu de base Nemesis, du studio polonais Awaken Realms, se détaille en anglais autour de 170 $. Pour mettre la main sur la mouture française, publiée au Québec l’année suivante, il faut débourser près de 300 $ ! Le prix au détail suggéré pour Endless Winter – Paleoamericans est de 59,99 $, mais il en coûtera une centaine de dollars pour obtenir l’équivalent franco à la fin du mois de janvier 2023. Galaxy Trucker en version originale : 29,99 $. La nouvelle édition en français ? Environ le double.
La très grande majorité des jeux de société, peu importe la langue d’édition, est fabriquée en Chine avec les mêmes matériaux.
Mission impossible
Ces écarts de prix contreviennent à l’article 54 de la Charte de la langue française, qui exige qu’un jeu en anglais « soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables ». Cela signifie notamment, selon l’OQLF, que les jeux en français doivent être vendus à un « prix similaire ».
Pour les détaillants, c’est souvent mission impossible.
« La seule façon d’y arriver serait d’augmenter les prix des jeux en anglais pour les arrimer avec les jeux en français. Mais là, tu ne vendras pas parce que tu vas être plus cher qu’en Ontario. »
— Martin Montreuil, copropriétaire de Randolph
« Il y a une portion qu’on peut absorber, mais il y a des limites, confirme Marc Beaudoin, directeur des opérations et du marketing chez Ilo, important distributeur québécois. Il faut quand même faire une marge. Les gens regardent un prix, mais pas nécessairement le travail en arrière. »
Avoir les moyens de ses ambitions
Plusieurs éditeurs étrangers se tournent vers des plateformes de sociofinancement comme Kickstarter ou Gamefound pour tester le marché ; ils proposeront d’abord une version originale anglaise et, selon la réponse de la ludosphère, lanceront le jeu dans différentes langues. « On voit quand même une amélioration dans les 10 dernières années, note Martin Montreuil, vlogueur et copropriétaire de Randolph. Quand j’ai commencé, c’était uniquement en anglais. Il n’y avait que les jeux qui étaient d’abord édités en français qui existaient en français. De plus en plus, on voit que le marché se globalise. » Un exemple : le géant du jeu Asmodee met en vente ses produits dans plusieurs langues et marchés en simultané. C’est sans compter la popularité grandissante des éditions multilingues.
Joueurs à la rescousse
Les traductions tardent ? Une communauté de joueurs francophones veille au grain pour traduire les règles et les éléments de jeu sur l’internet. « Gloomhaven, un des jeux les plus populaires depuis 2017, c’est un groupe de Français sur Facebook qui a traduit le jeu au complet, donne en exemple Martin Montreuil. C’est une bible narrative. L’éditeur en a obtenu les droits et a commercialisé le jeu en français. » Sur les réseaux sociaux, les joueurs sont aussi prompts à repérer les erreurs de traduction, ce qui pousse parfois des éditeurs à s’amender avec une deuxième impression. « Certaines traductions sont mal faites, et ça énerve », confirme Christian Lemay, fondateur du Scorpion masqué. Le problème ? Le recours à des sous-traitants et le jeu du téléphone, observe-t-il : « Si on se met à la place des autres éditeurs, la traduction allemande de nos jeux édités en français est faite à partir de notre version anglaise. Après ça, c’est traduit vers le coréen, vers le japonais, et je ne peux pas vérifier si la traduction est bien faite. »
Illustrations, scénario, personnages, narration, direction artistique : tous les acteurs de l’industrie contactés par La Presse aimeraient que les jeux de société soient considérés comme des produits culturels, exemptés de la Charte de la langue française, au même titre que les livres, les revues ou les disques.
Autoriserait-on L’Échange ou Archambault à vendre les albums de Taylor Swift à la seule condition que ses bluettes pop et ses livrets soient traduits en français ?
Déjà en 2016, les organismes Ludo Québec et Les Trois Lys, dont la mission est de promouvoir le « jeu de société moderne », avaient envoyé un mémoire au ministère de la Culture et des Communications pour demander une modification à l’article 54 de la Charte.
« Le jeu de société est davantage qu’un produit de consommation et nous croyons qu’il doit être reconnu pour ce qu’il représente : une démarche créatrice et artistique à plusieurs niveaux », y écrivaient-ils. « Malheureusement, au niveau de la législation, la Charte de la langue française ne reconnaît pas le jeu de société comme étant un produit culturel ou éducatif et cela pose problème. »
Jayson Pickford, président-directeur général d’Asmodee Canada, fait remarquer que les jeux de société « font désormais partie des espaces culturels », comme les musées.
« Le jeu de société peut être considéré comme un objet d’art à travers ses illustrations et son matériel. »
— Jayson Pickford, président-directeur général d’Asmodee Canada
Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français, croit pour sa part que la désignation des jeux de société comme objets culturels risquerait d’affaiblir… notre culture. « Ce n’est pas en anglicisant toute la planète pour accommoder les entreprises qu’on va réussir non seulement à protéger, mais aussi à faire avancer l’une des richesses patrimoniales qu’est la diversité linguistique et culturelle. »
De la pression en France
Le statut des jeux de société fait aussi l’objet d’un débat en France. « Au même titre que les livres ou les films, par exemple, ils appartiennent tout autant au monde de la culture, car il s’agit d’une expérience conceptuelle et humaine, d’une œuvre de l’esprit », a plaidé la sénatrice Nadia Sollogoub auprès du ministère de la Culture français, l’an dernier.
L’Union des éditeurs de jeux de société a d’ailleurs pour « mission principale » d’extraire les boîtes ludiques de l’industrie du jouet pour les faire entrer dans le secteur culturel.
« Au Québec, il n’y a pas de réseau organisé de détaillants de jeux, regrette Martin Montreuil, de Randolph. Ça sera difficile d’organiser une telle mobilisation, mais le rassemblement de l’Association québécoise de l’industrie du jouet [en mars 2023] peut être un point de départ pour discuter du dossier. »
Des exceptions pour les logiciels
Ce que les acteurs de l’industrie du jeu de société demandent au gouvernement ressemble en tous points aux dispositions prévues dans la Charte de la langue française pour les logiciels. Ce type de produits, lorsqu’offert en version anglaise, « doit être disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française ». Un prix plus élevé est en outre jugé acceptable « lorsque celui-ci résulte d’un coût de production ou de distribution supérieur ». Petite brèche dans l’article 54 de la Charte, qui concerne les jeux et les jouets : « Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu’il fixe, des dérogations ». Le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de la Langue française n’avaient pas répondu à nos questions au moment de publier.
